36 marches jusqu'en enfer et Livre des choses perdues (Le)
Comme je suis déjà un très (trop) vieux lecteur, il m’a semblé intéressant le temps d’une recension, d’analyser en parallèle deux ouvrages que la fortune (et le service de presse de Phenixweb) ont placés entre mes mains : 36 marches jusqu’en enfer de Sébastien Gollut, et Le livre des choses perdues de John Connolly.
De prime abord, ils ont en commun une couverture également désastreuse. Que se passe-t-il avec les maquettistes ? Ce qui touche à l’imaginaire est-il si connoté petite-enfance qu’il faille confier la couverture de tels textes à des stagiaires pré-pubères ? La pseudo bande dessinée du livre de Gollut est toute aussi inappropriée que le Ouh-la-tout-seul-perdu-dans-la-forêt-effrayante, façon Minimoy dépressif, du roman de Connolly.
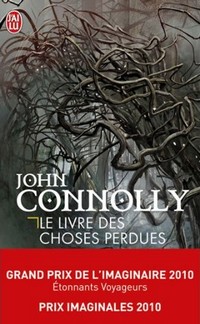
Le talent des graphistes eux-mêmes n’est pas ici contesté, mais bel et bien le choix des illustrations de couvertures, le fait d’apparier en l’occurrence des images naïves, voire puériles, à des écrits d’une rare noirceur. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, ces livres seront associés mentalement à des ouvrages pour enfants, alors qu’ils sont infiniment plus que cela.
Ils sont tous les deux centrés sur la mort et ses pièges, car la faucheuse est toujours tapie dans l’ombre de nos rêves et la poussière glorieuse de nos aventures. Comment y échapper sinon par une quête, par un espoir ? Ainsi Vincent Lamoul, le personnage central des 36 marches emprunte-t-il un escalier maléfique pour descendre sous les niveaux de la réalité quotidienne, et appréhender à chaque degré, à chaque palier, un nouvel univers, absurde et cruel, bien moins onirique que délirant. De même, le jeune David part-il de l’autre côté du jardin, dans un pays fantastique, pour porter assistance à sa mère récemment décédée dont il entend la voix et les appels au secours.
On ne revient jamais intact du royaume des ténèbres, que ce soient celles de la cave ou celles de l’autre côté du miroir. Mais chaque épreuve ne nous grandit pas obligatoirement. Elle nous force surtout à considérer quel individu est réellement celui dont nous parodions le personnage. Luigi Pirandello pensait que tout homme porte un masque, un masque pour les autres, et un masque pour lui-même, car l’homme ne connaît jamais la vérité de son être. Il l’anticipe, il l’approxime, au mieux, il transige avec elle, pour obtenir le droit de vivre serein. Connolly, comme Gollut, sait quelque chose de plus que les humains ordinaires, et c’est cela qui transparaît dans leurs livres. Des livres qui apportent leur lot de bonnes et de moins bonnes surprises.

Car si le fond est comparable, la forme ne l’est malheureusement pas, et le style différencie ces deux livres. Sébastien Gollut ne sait pas écrire : ses phrases sont remarquablement construites, ses paradoxes habilement fourbis, ses descriptions suggestives, mais la lecture de l’ensemble est difficultueuse, pénible parfois, notamment dans les dialogues, déroutants de platitude et manquant cruellement de vie. À cela, deux explications, d’une part la jeunesse de Gollut, qui cherche à écrire bien, à marquer les esprits par ses idées et ses trouvailles, au risque de fatiguer les lecteurs par ses errements de fort-en-thème. Et sur ce point précis, on pourra accuser sans doute la négligence de l’éditeur : outre la dissonance malencontreuse de la couverture, tendance manga, et du texte, tendance thèse violente, on pourra lui reprocher de ne pas canaliser l’énergie textuelle d’un auteur manifestement cultivé, mais dont le premier jet, prometteur, est encore gâché par des scories.
D’autre part, et c’est certainement la cause essentielle de ce demi-ratage (36 marches, sans être un chef-d’œuvre, propose des aperçus fort intéressants sur notre post-modernité), Gollut s’attaque de front à ce que les auteurs anglais du début du vingtième siècle appelaient le roman d’idées. Je ne connais que fort peu d’exemples aboutis d’un tel défi intellectuel, à part l’immense Contrepoint d’Aldous Huxley, qui révolutionne le genre, comme à son habitude. L’intention louable de Gollut est de proposer un abécédaire de la fiction, en mettant en lumière les côtés sombres de l’humain : il veut nous faire découvrir les contrées innommables de l’inconscient collectif, à l’aide de petites saynètes drolatiques autant que perverses, qu’il déroule en une chaîne narrative assez improbable, la descente d’un escalier. Malheureusement, il n’est pas le Fredric Brown de Fantômes et Farfafouilles, qui seul pouvait se permettre des nouvelles abouties en quelques pages à peine.
On ne sait pour quelle raison, Gollut met en œuvre une disposition dramatique trop lourde, en faisant intervenir d’une part un héros au sens mineur du terme, puisque l’on sait très peu de choses de lui à part son nom, et d’autre part, un narrateur omniscient qui apparaît à l’entrée et à la sortie de chaque nouvelle. Ainsi encadrés et commentés, les textes les plus intéressants deviennent de simples extraits, insérés dans une anthologie un brin ringarde de l’imaginaire au XXIe siècle. Tout ceci empêche le lecteur de participer à l’introspection savante de l’auteur, tant il est séparé de l’immédiateté des textes et de leurs qualités intrinsèques par un fâcheux effet de distanciation. C’est bien dommage.
À l’inverse, Connolly, en vieux routard des polars, utilise à merveille la technique du cône d’expansion : partir de la personnalité profonde du héros, un jeune garçon perturbé par la mort de sa mère, le remariage de son père, la découverte d’une nouvelle maison, pour créer une osmose avec le lecteur, et ensuite placer ce jeune garçon dans un monde parallèle, où toutes les règles et les apprentissages ne sont plus d’aucun secours. L’assimilation du lecteur au personnage de David est intense, et permet très vite au roman de dépasser le cadre d’un ouvrage de fantasy pour atteindre à un texte littéraire, profond et enthousiasmant : David se transforme au cours du livre, et acquiert une conception adulte du monde et de ses mystères, ce qui pose, à travers son aventure initiatique, la question du sens de l’existence et donne à ce livre des choses perdues un attrait incomparable. C’est à juste titre qu’il a été récompensé par le Grand prix de l’imaginaire 2010.
Bonne lecture à tous.
36 marches jusqu’en enfer par Sébastien Gollut , couverture : Zariel, Griiffe d’Encre Editions
Le livre des choses perdues par John Connolly , couverture : Perdita Corleone, traduction : Pierre Brévignon, Editions J’Ai Lu






