ANDREVON Jean-Pierre 01
(janvier 2007)
Né en 1937, Jean-Pierre Andrevon a passé une jeunesse solitaire où il pouvait déjà se raconter des histoires.
Voyons ce qu’il nous apprend sur son enfance, sur ses débuts dans la vie, sur les guerres qu’il a connues, sur ses espoirs et ses doutes.
VIE
Vous êtes né en 1937, parlez-nous de votre enfance.
Ce fut une enfance assez bizarre, pour deux raisons. La première est que j’étais le fils d’un ange de passage, un enfant sans père. En 1937, surtout dans le milieu (relativement) bourgeois de ma famille – mon grand-père maternel était un tailleur assez coté sur la place de Grenoble – ce n’était pas fréquent et plus mal vu encore. J’ai donc été élevé dans un grand appartement qui jouxtait le magasin, avec mon grand-père et ma grand-mère, ma mère et son frère - mon oncle et tuteur. Et puis, peu à peu, tous ces parents ont disparu. L’oncle en premier, qui est parti pour se marier, le grand-père ensuite, un homme que je trouvais effrayant et qu’à cet âge tendre je n’ai pas regretté, qui est mort alors que j’avais six ans. Et puis ma mère, la dernière, qui s’est mariée avec un homme qui n’était pas mon père biologique et n’a pas voulu de moi. J’ai donc vécu seul de 11 à 21 ans avec ma grand-mère, dans cet appartement de la place Victor Hugo qui devait bien faire 200 m². Dans la partie magasin, mon oncle avait succédé à son père, mais je le voyais très peu. Dois-je l’avouer ? Ces circonstances m’ont donné accès à une liberté dont peu de garçons et adolescents ont pu bénéficier en ces années de jadis, sévères pour ce qui est de l’éducation. Je n’avais certes pas beaucoup d’argent, mais je faisais ce que je voulais, je sortais quand et où je voulais. Et puis ma grand-mère est morte à son tour, fin 1958. Je l’ai perdue comme j’aurais perdu une mère, ce qu’en fait elle était, par procuration. Le portrait est donc là, non ? Un être solitaire, révolté aussi, pour qui toute règle était une règle en trop… La deuxième bizarrerie est la guerre, bien sûr. Même si Grenoble, situé en zone libre, la zone nono (pour non occupée), n’a été envahie qu’en novembre 42, j’avais donc 5 ans, par les Italiens d’abord, plutôt pacifiques, puis par les Allemands dix mois plus tard, ce qui changeait la donne. Résistance, arrestations, couvre-feu, rafles, Gestapo… on a connu tout ça, ce qui a occasionné pour la famille Andrevon en miettes de fréquents séjours à la campagne, où au moins on trouvait à bouffer et où l’on cultivait notre jardin – ce que j’adorais, d’où sans doute ma passion ultérieure pour la nature, puis l’écologie. J’ajoute que j’avais un deuxième oncle, le mari de ma tante, juif polonais, qui devait se cacher. A la libération de la ville, en août 44, à 7 ans donc, et sans bien sûr m’en rendre compte, j’étais « fait » : la nature, la liberté, la haine de l’uniforme et de la guerre, la méfiance envers la famille… J’y ajoute une rage meurtrière contre l’antisémitisme. Côté positif, de ces années reste au moins mon premier chat, déposé sur mon lit par mon oncle (le tailleur, pas le juif). Un petit noiraud que, beaucoup tard, ma grand-mère, qui ne le supportait plus, a fini par faire piquer, profitant de mes vacances. Malgré ma tendresse pour elle, je lui en ai toujours voulu. Tout est là, non ? Un (futur) homme, rien qu’un homme qui les vaut tous… mais Sartre a dit ça mieux que moi.
Pensez-vous que l’enfance a une grande importance dans l’élaboration de votre Imaginaire ?
Certainement, puisque l’homme en germe, dit-on, se forme essentiellement au cours des 7 premières années de sa vie. Pour moi, en tout cas, c’est patent. J’y ai expérimenté et accumulé les principales joies et douleurs (les filles exceptées) - à vrai dire plus de douleurs que de joies. L’imaginaire suit, il est modelé par ces expériences indissolubles. Pour preuve, la guerre et ses corollaires se retrouvent dans une bonne part de mes écrits (j’ai vu des gens abattus dans la rue) et inversement cette attention de tous les instants apportés à la nature (je passais des heures à plat ventre dans l’herbe à observer les insectes…), tout est là. Ajoutons la solitude d’un fils unique, qui me permettait, même si j’en souffrais aussi, parfois, de me centrer, de me concentrer sur l’observation de l’extérieur. Je crois qu’essentiellement je suis un œil grand ouvert, télescope et microscope. D’où mon écriture, descriptive, parfois à l’excès peut-être.
Avez-vous des souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale ? Si oui, lesquels ?
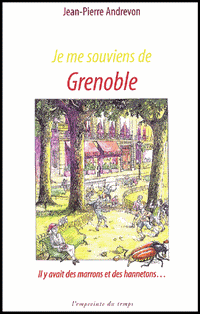 Des images, encore et surtout (que j’ai abondamment retranscrites dans mon livre de souvenirs Je me souviens de Grenoble) : le premier side-car monté par deux Allemands, arrivant sur la place principale du village de Sonnay en Isère (d’où était originaire mon grand-père et où j’ai encore de la famille), en juin 40. Un résistant tirant des coups de pistolets dans la vitrine d’un bistro d’où ont surgi deux soldats de la Wehrmacht en calot de ville qui se sont lancés à sa poursuite. Un bimoteur au fuselage bigarré, mince comme un crayon, rasant les toits de la ville (un Heinkel). A la campagne encore, ce soldat allemand d’août 44, le front ceint d’un pansement sanglant, capturé par des résistants armés de faux et de fusils de chasse et qui voulaient lui couper la tête. Et, toujours en août, le déferlement, cours Jean Jaurès, de l’armée alliée, avec les tanks Sherman et les Jeeps, et les bobbies qui nous lançaient du chewing-gum, des boîtes de Coca, du chocolat. Images, images… qui ne s’oublient pas. Et, pour mon esprit de gosse, bien plus passionnantes et fascinantes qu’effrayantes même si, plus tard, j’ai fait le tri, me penchant sur le drame du maquis du Vercors, autre sujet de fascination, mais rétrospectif cette fois (j’aurais voulu en être - tout en me posant cette question sans réponse : est-ce que, si j’avais eu l’âge, j’aurais eu le courage d’en être ?), d’où j’ai tiré mon roman pour la jeunesse : Vercors, la forteresse sacrifiée.
Des images, encore et surtout (que j’ai abondamment retranscrites dans mon livre de souvenirs Je me souviens de Grenoble) : le premier side-car monté par deux Allemands, arrivant sur la place principale du village de Sonnay en Isère (d’où était originaire mon grand-père et où j’ai encore de la famille), en juin 40. Un résistant tirant des coups de pistolets dans la vitrine d’un bistro d’où ont surgi deux soldats de la Wehrmacht en calot de ville qui se sont lancés à sa poursuite. Un bimoteur au fuselage bigarré, mince comme un crayon, rasant les toits de la ville (un Heinkel). A la campagne encore, ce soldat allemand d’août 44, le front ceint d’un pansement sanglant, capturé par des résistants armés de faux et de fusils de chasse et qui voulaient lui couper la tête. Et, toujours en août, le déferlement, cours Jean Jaurès, de l’armée alliée, avec les tanks Sherman et les Jeeps, et les bobbies qui nous lançaient du chewing-gum, des boîtes de Coca, du chocolat. Images, images… qui ne s’oublient pas. Et, pour mon esprit de gosse, bien plus passionnantes et fascinantes qu’effrayantes même si, plus tard, j’ai fait le tri, me penchant sur le drame du maquis du Vercors, autre sujet de fascination, mais rétrospectif cette fois (j’aurais voulu en être - tout en me posant cette question sans réponse : est-ce que, si j’avais eu l’âge, j’aurais eu le courage d’en être ?), d’où j’ai tiré mon roman pour la jeunesse : Vercors, la forteresse sacrifiée.
Votre vie est-elle à l’image de ce que vous espériez ?
Qu’est-ce que j’espérais ? Et à quels âges successifs ? J’ai commencé très tôt à dessiner (j’étais plutôt doué) et, un peu plus tardivement (vers 14/15 ans), à écrire - des nouvelles de SF, déjà. Je ne me voyais qu’artiste, créateur, c’est sûr. Mais, ayant fait tardivement (entre 20 et 23 ans) des études aux Beaux-Arts, je me voyais plutôt peintre. Puis j’ai essayé d’obliquer vers la bande dessinée. Le hasard, les circonstances m’ont poussé et maintenu dans l’écriture, que je n’avais jamais abandonnée, quand les premiers « succès » sont venus. J’ai donc continué dans cette voie, sans abandonner les autres, auxquelles je peux ajouter la chanson. Ceci dit, la vie se résume-t-elle à ce qu’on y fait ? Plutôt qu’a ce qu’on en fait ? Réussir dans la vie, réussir sa vie, vieux dilemme… Ceci dit, je n’ai pas à rougir de mon parcours d’homme et de citoyen (oui, oui, je tiens à ce mot), jusque dans ce qu’on peut appeler « mes engagements » - mais on y reviendra je pense…
Regrettez-vous certaines choses ? Avec le recul, auriez-vous fait certains choix de vie différemment ?
La vie n’est faite que de regrets (ce qu’on n’a pas pu faire) et de satisfactions (ce qu’on a fait - quand on l’a bien fait). Bon, je sens que je vais pontifier - un de mes menus défauts. Disons qu’étant un boulimique, un coureur après les comètes, un jamais-content, je regrette de n’en avoir pas fait dix fois plus, ou au moins deux. Ceci concernant mes activités créatrices. Longtemps, par exemple, je me suis morfondu d’avoir publié mon premier roman à 31 ans, quand certains le font à 18 - de Radiguet à Gérard Klein ( !). Regrets stériles, bien entendu. On fait ce qu’on a à faire quand on peut le faire et quand on sait le faire, tout le reste est (mauvaise) littérature. Ou bonne, s’il s’agit de mettre en marche sa machine à voyager dans le temps, mais il ne s’en trouve pas à l’épicerie du coin. Pour le reste, je ne crois pas avoir jamais fait de choix véritable. J’ai plutôt attendu que ça vienne, en me fiant à ma bonne étoile. J’ai suivi le courant, choisissant tout au plus la bonne rivière…
Avez-vous des enfants, des petits-enfants ?
Est-ce une question – piège relatif à mon obsession justifiée au sujet de la surpopulation ? Mon ex-femme et moi avons eu deux enfants, un garçon, Philippe, aujourd’hui 41 ans, qui donne (bien) dans l’informatique - responsable entre autres de mon site. Et une fille, Fabienne, 35 ans aux fraises, qui travaille dans l’humanitaire et fait un peu de critique de cinéma. Philippe et sa compagne ont eu - aïe, aïe, aïe ! - trois enfants. C’est la vie, comme disait mon oncle (le juif, pas le tailleur).
Quels ont été vos différents métiers ?
J’ai dû quitter le lycée à 16 ans, à la fin de ma 3e, ce qui éclaire cruellement mon assiduité et mon talent pour les études. Mon oncle (le tailleur, pas le juif), ayant décidé qu’il était temps que je gagne ma vie, m’a trouvé une place de dessinateur aux Ponts-et-chaussées, où je suis resté quatre ans - la pire période de ma vie. Je m’y suis ennuyé comme un rat mort, je ne foutais rien de rien (à part écrire en cachette mes premiers textes), je ne parlais à personne. Harpo Marx chez Kafka. Disons que j’ai effectivement gagné quelques sous, pour m’acheter ma première guitare, ma première moto (une 125 Peugeot). Et puis, à 20 ans, j’ai passé le concours d’entrée à l’Ecole des Beaux-arts de Grenoble, d’où je suis sorti, après une période de vaches très maigres, avec un diplôme me permettant d’enseigner. J’ai donc été prof de dessin (on ne disait pas encore « arts plastiques ») dans divers lycées et collèges pendant six ans (cette période ayant été coupée en deux par mon service militaire en Algérie). L’uniforme ôté, j’ai également été engagé comme pigiste dans un quotidien régional, LE PROGRÈS, où je me suis rapidement spécialisé dans la critique cinéma (je venais de me marier, ma femme était encore étudiante, il me fallait gagner ma vie pour deux, et très vite trois). Et puis, entre 68 et 69, patatras, je n’ai plus obtenu de poste dans l’éducation Nationale (je n’étais que maître auxiliaire, espèce en voie de disparition) et l’édition grenobloise du PROGRÈS a cessé de paraître. Mais voyez, quand je parle de bonne étoile : ma première nouvelle a été publiée dans FICTION en 68, mon premier roman en 69. Après, je n’avais plus, comme je l’ai dit, qu’à suivre le courant, au départ un tout petit ruisseau. Mais j’ai aussi donné dans l’animation culturelle, entre autres en organisant, en décembre 71 en la fastueuse Maison de la Culture de la ville, un « Mois de la science-fiction » qui, je crois, a marqué.
Vous avez fait votre service militaire en Algérie, pendant les événements que l’on connaît. Quels souvenirs cela vous a-t-il laissé ?
Bien moins douloureux qu’on pourrait penser. Il me faut préciser que je suis arrivé en Algérie début mars 62, quinze jours avant le cessez-le-feu. Je n’ai donc guère eu l’occasion de tuer, de violer, de torturer, de risquer ma peau. Mais, l’armée d’occupation française n’ayant pas été dissoute comme par magie à cette date, pas plus d’ailleurs qu’après l’Indépendance en juillet suivant, j’y suis tout de même resté 14 mois. J’ai quand même été pris dans une embuscade en rase campagne, qui s’est soldée par plusieurs morts… Non, je n’ai pas eu spécialement la trouille. Mon meilleur souvenir (car il y en eut) reste précisément le jour de l’Indépendance où, alors que toutes les troupes étaient consignées dans les casernes, j’avais pu néanmoins sortir dans Alger, pour la bonne raison que j’étais le chauffeur (de jeep) de mon capitaine. Et là, j’ai vu déferler pacifiquement une marée de jeunes gens et filles vêtus en vert-blanc-rouge, les couleurs de la nouvelle Algérie indépendante. Nous les avons regardés passer, sans qu’un seul mot, un seul geste hostile à notre égard aient été tenté. L’islamisme, on ne connaissait pas, à l’époque. Ce sont des images, encore des images, que je n’oublie pas. A part ça, je me suis ennuyé à peu près autant en Algérie qu’aux Ponts-et-chaussées : que fait un militaire en temps de paix ? Que dalle. Pendant des décennies, j’ai subi des rêves où je me voyais refaire mon service militaire (ou, variante, que je « travaillais » toujours aux Ponts-et-Chaussées). On a les enfers qu’on peut, les miens ont été, tout compte fait, bien anodins… J’ajoute une chose : pendant mes études, j’avais intégré, comme responsable, l’UNEF à l’AGEG de Grenoble, où j’étais en charge des relations internationales (entre parenthèses, c’est une autre de mes expériences formatrices - la dernière sans doute). Or, en ce temps-là, l’UNEF était le fer-de-lance du combat pour « la paix en Algérie ». Je suis donc arrivé à l’armée avec, au cul, un rapport de la Sécurité militaire qui m’interdisait, ce sont les termes, « de bureau et d’avancement ». Donc, moi, sursitaire intello, et alors que tous mes copains ont fini caporal-chef ou sergent, j’ai été renvoyé dans mes foyers deuxième classe comme au premier jour. Dois-je préciser que j’en suis particulièrement fier ?
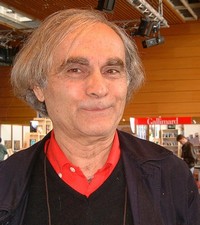
Par quoi êtes-vous fasciné ?
Encore faudrait-il savoir ce qu’est la fascination… Je crois, comme Flaubert, être fasciné par la bêtise, ce qui s’accompagne tout naturellement de dégoût et de haine (un paragraphe qui devrait être développé, mais je préfère passer outre…) Je suis aussi fasciné, plus honorablement, par les créateurs qui réussissent pleinement ce qu’ils ont entrepris, et qui bien sûr rencontrent ma propre sensibilité, mes propres intérêts : Picasso, Chaplin, Hergé… mais il y en a beaucoup ! De manière plus directe, plus sensitive et sensuelle, plus éphémère aussi, je peux être fasciné par ce qui me tombe sous le regard : un pollen qui danse dans la lumière, la manière infiniment gracieuse dont une fille, assise en terrasse de bistro en face de moi, croise et décroise les jambes, la manière infiniment gracieuse qu’a un de mes chats pour s’étirer au soleil, le cheminement d’un insecte dans l’herbe… où le vieil Andrevon rejoint le garçon de 5 ou 6 ans. Je ne crois pas avoir beaucoup changé en 60 ans…
Quel est votre principal trait de caractère ?
L’impatience, et l’énervement qui va avec.
Qu’est-ce qui vous énerve ?
Tout ce qui se met en travers de mon chemin dans le quotidien le plus au ras des pâquerettes. Les problèmes d’ordinateur et d’Internet, mes lunettes que je ne retrouve pas, l’attente au restaurant ou au bistro quand le serveur frôle ta table et que tu te sens invisible… Passionnant, hein ? Je peux ajouter : le genre de question qui vient juste après celle-ci…
Outre l’écriture, quels sont vos hobbies ?
Voilà ! C’est quoi un hobby ? Mon petit Larousse dit : « Passe-temps favori servant de dérivatif aux occupations habituelles… » L’écriture en serait, des fois ? La peinture, même si elle a rétrogradé loin en arrière dans ma quotidienneté, le temps n’étant pas extensible, n’est pas un hobby pour moi ; elle obéit au même genre de nécessité, au même genre d’envie que l’écriture. C’est une autre façon de m’exprimer, de parler au monde (tout en parlant du monde). J’en dirais autant de la chanson, et de tout ce que je fais et fabrique, même si c’est microscopique. La notion même de passe-temps m’est étrangère, précisément parce que le temps, je suis perpétuellement en train de lui courir après. De même que la notion de jeu : je joue avec les mots, les images, les sons parfois, et ça me suffit amplement. Où trouver le temps et l’intérêt pour le reste ? Oui, quand même un peu. Je ne voudrais pas donner l’image de la momie scotchée derrière son ordinateur : je réussis tout de même à prendre le temps de la marche en campagne et en montagne et du vélo sur les petites routes. Mais ce n’est pas un « hobby », c’est une nécessité.
Quel est le don que vous regrettez de ne pas avoir ?
L’ubiquité. Je serais plus sceptique sur l’immortalité, encore que…
Quel est votre rêve de bonheur ?
L’île déserte avec tout le confort moderne, dont une bonne parabole ? Je plaisante… enfin, un peu. J’ai autrefois calligraphié sur une de mes toiles ce poème d’Apollinaire : « Je souhaite dans ma maison /Une femme ayant sa raison/Un chat passant parmi les livres/Des amis en toutes saisons/Sans lesquels je ne puis vivre ». C’est une belle définition du bonheur. A moins que ça fasse beaucoup ? Mais quoi enlever, dans ce cas ? Pas le chat, c’est sûr…
Vos héros dans la vie réelle ?
Qui a dit : heureux les peuples qui n’ont pas besoin de héros ? Les vrais héros sont invisibles, ils sont multitude. Mais ce ne sont pas ceux des livres d’Histoire, pas ceux qui courent poitrine nue au devant de balles - ça, c’est de la connerie. Il suffit de faire quelque chose de bien pour l’Autre, son frère, sa sœur, chaque jour, ou dix fois par jour, pour atteindre à une sorte d’héroïsme parce que, croyez-moi, ce n’est pas facile. Les pesanteurs, la lâcheté, l’indifférence… Je réponds à cette partie du questionnaire le « Jour des Justes ». Alors oui, aujourd’hui, celui qui a été un Juste pendant la guerre est pour moi un héros.
Si vous rencontriez le génie de la lampe, quels voeux formuleriez-vous ?
Je chasserais le génie, je garderais la lampe, pour y voir un peu mieux dans l’obscurité.
Citez-nous 5 choses qui vous plaisent.
Les chats, dont je ne peux me passer. Les babas au rhum. Le grand vent qui fait s’envoler les feuilles et les tuiles. L’odeur des pages d’un livre neuf. Les marchés aux fruits et légumes. Quoi ? Seulement cinq ?
Cinq choses qui vous déplaisent ?
Les gens qui parlent fort dans les lieux publics (particulièrement à leur portable, que j’ai chaque fois envie de leur faire bouffer). Les gens qui me disent : on va bien se marrer, on va bien se soûler la gueule (sans moi, les gars). La brutalité des enfants, race surnuméraire. Le bruit du verre brisé. Faire la gueule, parfois sans raison véritable, et ne pas pouvoir m’en empêcher. Quoi ? Seulement cinq ?
Plus de 100 livres à son actif. Andrevon a touché aussi bien la SF, que le fantastique, le polar, l’humour, la bd. Mais aussi la peinture et le dessin, la critique de livres ou de cinéma. Voyons ce qu’il nous apprend sur ses différentes activités.
OEUVRE
Ecriture
A quel âge avez-vous commencé à écrire ?
Probablement vers 14/15 ans, alors que j’étais en 4e. A cette époque, j’avais fait connaissance avec la SF à travers « Anticipation » du Fleuve Noir et « Le Rayon fantastique ». J’étais tombé en science-fiction comme Obélix dans le chaudron - même si ma première connaissance du genre remonte à bien plus avant, mes 7 ou 8 ans, alors que je lisais La Guerre des mondes de Wells et, dans COQ HARDI, la bd de Marijac et Liquois, Guerre à la Terre, mon choc jamais cicatrisé - puisque je relis cette bande, périodiquement, aujourd’hui encore. Donc mes premiers brouillons de nouvelles, sur des cahiers, datent de cette époque. Mais ils avaient été précédés par des bandes dessinées, des westerns et surtout une aventure inédite des Trois mousquetaires, que j’avais située entre le roman initial et Vingt ans après. Je la dessinais pendant les cours de français-latin d’un prof bonasse, en 3e, et la faisais lire à mes copains ravis.
Vous souvenez-vous encore de vos premiers textes ? Que sont-ils devenus ?
Ce n’étaient que des débuts d’histoires, jamais achevés. Ils ont disparu avec les cahiers ou les feuilles de copie qui les portaient. Je crois que je m’essayais à des histoires de voyages dans le temps, un thème qui m’a toujours… fasciné. Les bandes dessinées ont disparu avec eux. Ma palette s’est élargie pendant mes quatre ans aux Ponts-et-Chaussées. J’y avais commencé un roman d’invasion extraterrestre, suscité par un rêve (comme beaucoup de mes textes ultérieurs) où je voyais d’épouvantables monstres noirs à grandes pattes surgir des chaussées fracassées en pleine ville. Une séquence que j’ai retrouvée 50 ans plus tard avec l’apparition du premier tripode dans le film de Spielberg, ce qui me permet de rattraper Wells au passage. Encore un texte inachevé et perdu. Par contre, c’est bien aux Ponts-et-Chaussées, loués soient-ils, que j’ai écrit mes premières nouvelles publiées (dix à quinze ans plus tard) dans LUNATIQUE, FICTION, puis dans mon premier recueil, Aujourd’hui, demain et après.

Quels sont vos « parrains » en écriture ?
Le seul vrai, je l’ai souvent déclaré, est Barjavel, que j’ai découvert assez tardivement, avec la réédition de quelques-uns de ses romans en « Présence du futur ». C’est à lui que j’ai adressé, ayant pu avoir son adresse par un journaliste du PROGRÈS, mon premier livre que je jugeais publiable : un recueil de nouvelles courtes (jamais publié pourtant). René m’a répondu dans les deux ou trois jours, me disant que j’étais un vrai écrivain. Je ne l’oublierai jamais. Ce pourquoi à ceux qui, hier et aujourd’hui, croient bon de dénigrer Barjavel, et sauf votre respect, je chie à la gueule.
Comment écrivez-vous ?
Dans la passion, bien sûr ! Techniquement, j’ai suivi le cours des progrès matériels, passant de la plume à la machine à écrire mécanique, puis électrique, puis au traitement de texte, où je suis venu assez tard, en 1995. Bizarrement, j’ai toujours (et jusqu’à une date très récente) écrit mes nouvelles avec un premier jet au stylo et à l’encre verte (puis au feutre doux), avant de les taper. Par contre j’ai toujours tapé directement mes romans, et ce dès Les Hommes-machines. Je suis incapable d’expliquer pourquoi, sauf le gain de temps, victoire sur mon vieil ennemi. Mais dans tous les cas, je pars d’un synopsis assez précis, et même de plus en plus précis à mesure que j’évolue. Quoi encore ? J’écris matin et après-midi, quelques heures par jour, pas énormément. Et au grand jamais dans la fébrilité, l’alcool, la musique à fond le casque (je n’ai pas de casque) jusqu’à cinq heures du matin.
Pourquoi l’écriture ? Quel est, selon vous, le rôle de l’auteur dans notre société ?
Pourquoi fait-on quelque chose ? Parce que ça vous plaît, parce qu’on a envie de le faire… Et si on a envie de le faire, c’est parce qu’on l’a vu faire chez un autre. Le processus est le même que chez le gamin de banlieue qui rêve d’être champion de foot parce qu’il admire Zizou. J’ai aimé les histoires de SF que je lisais gamin, l’envie m’est venue de créer mes propres histoires. Pareil pour la chanson : j’ai bien écouté Brassens, et en avant pour la guitare ! Au départ, je ne me suis surtout pas posé la question du rôle de l’écrivain. C’est venu plus tard, avec ma conscience d’homme, de citoyen (nous y revoilà !), agissant dans et sur la société. Tout en étant conscient, avec Sartre, que « toute la littérature du monde n’empêchera jamais un enfant de mourir de faim ». Et pensant néanmoins, avec le Zola de « J’accuse », que ce n’est peut-être pas vrai, qu’il ne faut jamais baisser les bras, que tout acte qui va dans la bonne direction doit être accompli. L’écriture est un de ces actes, ni plus, ni moins. Pour ce qui de l’impact immédiat, le meilleur roman du monde sera moins efficace qu’un bon article de journal. A plus long terme, c’est certainement différent.
Voilà, vous êtes l’un de ceux qui nous ont ouvert les portes de la SF et de la SF française. Alors en raison de l’évolution du monde, qu’en est-il de l’acte d’écrire de la science-fiction par rapport à vos débuts dans les années soixante-dix ?
J’ai ouvert une seule porte : celle de ma chambre, qui donne sur la rue en bas de chez moi (« La poésie est dans la rue ! » chante Ferré). Qui passe dans cette rue ? Je connais une poignée de ces passants. Les autres… Rien ne me paraît pire que les donneurs de leçons, et le pire du pire, c’est que certains me considèrent ainsi. « Suivez ceux qui cherchent la vérité, fuyez ceux qui prétendent l’avoir trouvée », a écrit Lao-Tseu. J’écris ce qui me tombe dans la tête et, de ma tête, tombe sur ma feuille. J’écris ce que je suis. Et qui suis-je ? Un homme à cheval entre un XXe siècle pas joli-joli et un XXIe qui sera pire, un type qui regarde la réalité dans les yeux, le contraire de l’artiste enfermé dans sa tour d’ivoire, un militant écologiste et d’extrême gauche, un athée farouchement anticlérical à la mode des anars du début de l’autre siècle, un matérialiste pur jus, un foutu moyenâgeux mental qui se moque de tout ce qui commence par « psy » et par « philo », un amoureux de la nature, et des femmes, et des chats… j’en passe et de pires. Tout ça doit se retrouver, clandestinement ou pas, dans mon écriture. Mais quel écrivain prétendrait le contraire ? Alors y a-t-il changement d’optique entre les années 70 et 2000 ? Certainement pas puisque, dans un monde qui change, je n’ai pas changé…
La subversion, l’engagement politique a-t-il toujours sa place dans le choix d’écrire de la science-fiction plutôt qu’autre chose ?
 Je crois que la SF, plus que tout autre littérature, facilite l’appréhension du monde, et y pousse. C’est écrire l’histoire du futur, (de multiples histoires du futur) comme on peut écrire l’histoire du passé ou du présent. La SF manifeste notre désir du monde comme notre peur du monde. Les grands livres de SF, Le Meilleur des mondes ou 1984, témoignent de cette peur, de cette inquiétude lucide en tout cas. D’ailleurs on ne les considère pas comme faisant partie de la SF, puisqu’ils se sont dissous dans le bain de la réalité. Ceci dit, étant donné que j’ai écrit bien autre chose que de la SF, ma réponse doit être forcément nuancée. Encore une fois, et qu’on me comprenne bien, je ne décide pas d’ajouter dans mes romans une pincée d’engagement ou de contestation comme on mettrait un peu de piment dans le couscous pour en rehausser le goût. J’écris d’abord et avant tout, puisque je suis romancier et pas journaliste ou homme politique, pour le « plaisir du texte », selon la bien belle formule de Barthes. Le « Tuez tous les affreux ! » y est ou n’y est pas, mais c’est question de thématique essentiellement.
Je crois que la SF, plus que tout autre littérature, facilite l’appréhension du monde, et y pousse. C’est écrire l’histoire du futur, (de multiples histoires du futur) comme on peut écrire l’histoire du passé ou du présent. La SF manifeste notre désir du monde comme notre peur du monde. Les grands livres de SF, Le Meilleur des mondes ou 1984, témoignent de cette peur, de cette inquiétude lucide en tout cas. D’ailleurs on ne les considère pas comme faisant partie de la SF, puisqu’ils se sont dissous dans le bain de la réalité. Ceci dit, étant donné que j’ai écrit bien autre chose que de la SF, ma réponse doit être forcément nuancée. Encore une fois, et qu’on me comprenne bien, je ne décide pas d’ajouter dans mes romans une pincée d’engagement ou de contestation comme on mettrait un peu de piment dans le couscous pour en rehausser le goût. J’écris d’abord et avant tout, puisque je suis romancier et pas journaliste ou homme politique, pour le « plaisir du texte », selon la bien belle formule de Barthes. Le « Tuez tous les affreux ! » y est ou n’y est pas, mais c’est question de thématique essentiellement.
Considérez-vous la SF comme faisant partie de la littérature, ou ne faisant pas partie du mainstream ?
Question piège ou question cliché ? J’ai déclaré une fois - mais c’était une boutade - que ce n’était pas la SF qui faisait partie de la littérature, mais la littérature qui était une petite partie de la SF. Il me semble que Versins approuverait. La SF ouvre tant de possibilités ! Mille fois plus que la littérature contemporaine, prisonnière de la réalité et de l’instant présent. La SF sort des murs de la chambre à coucher pour pénétrer dans l’infini. Et la littérature générale (ou caporale) est bien obligée, sous peine de tourner le dos au monde, d’intégrer des éléments qu’on pourrait croire appartenir exclusivement à la SF : la génétique, les OGM, les univers virtuels de l’informatique, etc. Et vous voulez le fond de ma pensée ? Qu’est-ce qu’on en a à foutre ? Un bon livre est un bon livre. Et à un bon livre, on ne colle pas d’étiquette.
Quel est votre auteur de SF préféré ?
Un seul, impossible. Je vais citer à nouveau Barjavel, avec Stefan Wul et Silverberg. Avec Sternberg (de toute façon inclassable), pour former un quatuor à cordes honorable. Et quelle place accorder à Stephen King, dont la force de frappe m’époustoufle ? Mais tant d’autres piaffent devant la porte !
Quel est votre auteur non SF préféré ?
Pareil en pire. J’ai été formé par mes lectures autant que par les événements. Et, comme les événements qui m’ont marqué, les auteurs se sont succédés dans le désordre au cours de mon adolescence et de ma jeunesse. Je pourrais citer Giono (pour son approche sensuelle de la nature), Marcel Aymé (pour sa fantaisie au quotidien), Sartre qui, plus que n’importe quel autre auteur, m’a été un modèle d’expression et de construction avec sa trilogie Les Chemins de la liberté. Ensuite sont venus Buzzati, Cavanna, Bukovski, autre trio que je place en haut de l’échelle. Ma dernière découverte, c’est Nicholson Baker. Qui aura lu Le Point d’orgue comprendra pourquoi. Sans oublier les poètes, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, Aragon (celui des poèmes de la Résistance). J’ai d’ailleurs mis en musiques, comme tout guitareux qui se respecte, certaines œuvres de tous ceux-là. Ensuite viennent Prévert et Boris Vian, par qui se referme la boucle vers la SF
Quel est votre roman de SF préféré ?
Qui aurait envie de manger son plat préféré à tous les repas ? Qui pourrait oser dire qu’il possède LE livre dans sa bibliothèque, celui qu’il sauverait de l’incendie (« je sauverais le feu », a dit Cocteau - je préfère déjà ça), celui qu’il emporterait sur son île déserte ? Peut-être le Coran, pour un musulman qui n’a jamais lu que ça toute sa vie. Non, désolé, c’est une question impossible. De plus, il y a tant à découvrir que je relis peu, ou alors essentiellement pour des raisons professionnelles. Les deux roman de SF que j’ai dû relire le plus souvent (trois ou quatre fois, pas plus) sont La Guerre des mondes et Niourk. Mais c’est parce qu’ils sont courts ! (rire)
Quel est votre roman hors SF préféré ?
Pffff… Allez, je repique aux Chemins de la Liberté.
Quel livre d’un autre auteur auriez-vous désiré avoir écrit, soit parce que vous êtes jaloux de ne pas avoir eu l’idée le premier, soit parce que vous auriez traité l’idée d’une autre manière ?
 C’est une envie, une impression, une pulsion qui me vient souvent, mais elle est assez fugace. Parfois, je vais jusqu’à penser : « C’est trop bien, à quoi servirait que j’écrive encore ? ». Mais rassurez-vous (ou pas), c’est fugace aussi. Un seul titre ? Non. Mais la moitié de ce qu’ont écrit Barjavel, Wul, Silverberg - je reviens toujours aux mêmes. Spécialiste de la fin du monde, j’ai dû avoir ce découragement admiratif en lisant Malevil de Robert Merle. Et spécialiste de l’écologie, avec Tous à Zanzibar de Brunner. De toutes façons, en SF, les rencontres, les coïncidences affluent. Tenez, je viens de lire Les Quarante signes de la pluie de Kim Stanley Robinson. Page 386, des volontaires libèrent les animaux du zoo de Washington ; ce sont des lignes qui pourraient être tirées de La Nuit des bêtes ! En fait, c’est plutôt au cinéma que je récupère des idées, dont je ne fais en général rien, d’ailleurs. Deep Impact ou Armageddon m’ont certainement fait regretter de n’avoir jamais écrit LE roman sur le météore terminal, parce que c’est un des sujets qui me passionnent, excitent mes petites cellules grises. Mais d’autres l’ont fait, alors à quoi bon ? Tiens, si, quand même (j’ai l’esprit de tiroirs, vous avez dû vous en rendre compte), j’aimerais réécrire Le Choc des mondes de manière moins guindée, plus crédible scientifiquement. Peut-être à travers une suite de nouvelles, comme Le Monde enfin. Mais je sais bien que je ne le ferai jamais…
C’est une envie, une impression, une pulsion qui me vient souvent, mais elle est assez fugace. Parfois, je vais jusqu’à penser : « C’est trop bien, à quoi servirait que j’écrive encore ? ». Mais rassurez-vous (ou pas), c’est fugace aussi. Un seul titre ? Non. Mais la moitié de ce qu’ont écrit Barjavel, Wul, Silverberg - je reviens toujours aux mêmes. Spécialiste de la fin du monde, j’ai dû avoir ce découragement admiratif en lisant Malevil de Robert Merle. Et spécialiste de l’écologie, avec Tous à Zanzibar de Brunner. De toutes façons, en SF, les rencontres, les coïncidences affluent. Tenez, je viens de lire Les Quarante signes de la pluie de Kim Stanley Robinson. Page 386, des volontaires libèrent les animaux du zoo de Washington ; ce sont des lignes qui pourraient être tirées de La Nuit des bêtes ! En fait, c’est plutôt au cinéma que je récupère des idées, dont je ne fais en général rien, d’ailleurs. Deep Impact ou Armageddon m’ont certainement fait regretter de n’avoir jamais écrit LE roman sur le météore terminal, parce que c’est un des sujets qui me passionnent, excitent mes petites cellules grises. Mais d’autres l’ont fait, alors à quoi bon ? Tiens, si, quand même (j’ai l’esprit de tiroirs, vous avez dû vous en rendre compte), j’aimerais réécrire Le Choc des mondes de manière moins guindée, plus crédible scientifiquement. Peut-être à travers une suite de nouvelles, comme Le Monde enfin. Mais je sais bien que je ne le ferai jamais…
Comment considérez-vous l’évolution de la SF ces 40 dernières années ?
Pourquoi 40 plutôt que 30 ou 50 ? Je ne vois pas cette évolution comme une ligne droite, plutôt comme une sinusoïde. Et il y a 40 ans, en France, la SF était au plus bas : la preuve, je n’avais pas encore débuté (rire). Disons que je constate avec accablement la place prise par l’heroic fantasy, qui me gonfle, mais avec satisfaction un vif renouveau des préoccupations écologiques et sociétales, telles qu’elles étaient à l’œuvre dans les années 70.
Quels sont pour vous les auteurs majeurs de ces 20 dernières années ?
Dan Simmons ? Mais il a débuté bien avant, je pense. Alors Stephen Baxter (le nouveau Clarke) et Kim Stanley Robinson, l’auteur « écologique » par excellence. En France, Pierre Bordage et Dantec (même si je ne partage pas ses idées). Pour ce qui est fantastique, qu’on ne saurait oublier, Neil Gaiman.
Vous êtes un auteur prolifique, comment faites-vous pour écrire autant et depuis aussi longtemps ?
Comme je ne me pose pas cette question, il m’est difficile d’y répondre. L’envie, la passion sont les causes principales, j’y reviens toujours. Je me mets à mon ordinateur (autrefois la machine à écrire), les phrases s’enchaînent. Quand un bouquin (ou une nouvelle) est fini, quel que soit le temps que j’y ai passé, je saute au suivant, avec un entracte qui peut varier de quelques jours à quelques semaines. Je sais toujours quoi écrire, puisque j’accumule les synopsis et que, dans mes vastes tiroirs, il y en a des dizaines et dizaines en attente, bien plus que je n’aurais jamais le temps de développer. D’autre part je ne connais pas « l’angoisse de la page blanche » - une expression pour moi dénuée de signification. Ce qui ne veut pas dire que je n’aie pas des petits coups de fatigue. Mais alors je vais gratter ma guitare, je m’amuse avec mes chats, le fais un tour en vélo… et c’est reparti !
Vous écrivez également dans des genres différents (SF, fantastique, polars, etc.). Comment faites-vous pour passer d’un genre à l’autre avec autant de facilité ?
Je vais me répéter, et même radoter, mais c’est l’envie, toujours. J’ai accumulé tant de lectures que les modèles sont là, toujours.

En 1980, vous déclariez dans « Le Citron Hallucinogène » : « La SF aurait plutôt tendance à me fatiguer, parce qu’il me semble qu’en tant qu’auteur j’en ai fait le tour en douze ans de pratique intensive ; et aussi parce qu’elle tend à se confondre avec la littérature en général, ce qui au demeurant n’est pas une mauvaise chose, pour la littérature générale particulièrement. » Etes-vous toujours d’accord avec vos propos ?
Que la SF - ou tout au moins une certaine partie de la SF, celle que je pratique et qui exclue le space-opera ou la fantasy - se fonde au mainsteam, c’est certain, même si le mouvement inverse est également vrai. Mais je me suis déjà exprimé à ce sujet. Que j’aie pu affirmer qu’au bout de douze ans j’en avait fait le tour fait partie de ce genre de déclaration qu’on lance sans beaucoup y réfléchir et qui n’est plus vraie un an plus tard. Il se trouve que j’ai commencé à écrire pour la jeunesse dans les années 80 (c’était surtout affaire de circonstance), puis du polar dans les années 90… Mais en ce qui concerne le polar, j’avais bien l’intention, dès mes débuts, et même avant mes débuts, d’en écrire. Seule m’en avait empêché mon incarcération en SF des années 70, où nous avions le vent en poupe, où il ne fallait pas laisser la tempête s’essouffler.
Bizarre, je viens de jeter un oeil sur le net pour voir ce que l’on dit sur vous, et j’en tire une seule réflexion...
Pour quelqu’un de considéré comme un avant-gardiste contestataire, tout ce que l’on trouve sur vous est d’une platitude formatée...
Avez-vous déjà constaté cela et est-ce que cela vous gêne ou vous rassure d’être comme rentré dans le moule avec les années ?
« J’suis pas une moule ! » chantait Magali Noël sur des paroles de mon grand frère Boris. On m’a quand même cassé pas mal de sucre sur le dos. Mais ne dit-on pas qu’il vaut mieux entendre parler de vous en mal que pas du tout ? De toute façon, si je lis (en diagonale) ce qu’on peut écrire sur moi, cela ne m’influence aucunement. Sinon, dans les années 70, je n’aurais plus eu qu’à me cacher dans un trou de souris. Mais sans doute les idées que nous étions quelques-uns à défendre dans ces années-là en les faisant passer dans nos textes sont-elles devenues banales, parce qu’indéniables - et c’est heureux : je pense à l’écologie, encore et toujours. Plus personne n’oserait encore écrire que je suis, que nous sommes des emmerdeurs.
Vous travaillez également en tant que journaliste, comme critique cinéma ou littéraire. Comment concevez-vous cet aspect-là alors que vous êtes un créateur vous-même ?
Il se trouve que c’est la même année, en 1964, que LUNATIQUE a publié mes premières nouvelles de SF, et LE PROGRÈS mes premières critiques cinématographiques (et théâtrales). Et encore je ne compte pas mes brouillons dans des journaux étudiants. Les deux disciplines ont donc de tout temps, pour moi, été parallèles. Et se complètent, ajouterais-je. Être critique, quand on crée soi-même, c’est s’appuyer sur une connaissance vécue, en profondeur, de ce qu’on critique. Donc cela devrait vous éviter (en théorie) les injustices et les jugements à l’emporte-pièce. De plus, étudier une œuvre, c’est tenter de comprendre comment elle fonctionne. Donc, pour un auteur, c’est bénéfique. J’ajoute, en ce qui concerne plus précisément la critique cinéma, qu’elle est aussi pour moi une manière de m’approprier, si peu que ce fut, un art qui me fascine et que je ne pratique (hélas) pas.
C’est quoi un bon critique pour vous ?
Celui dont la sincérité est la première vertu. Celui qui ignore les modes et les goûts du jour, les clans et les castes, les pressions de quelque bord qui soit. Celui qui juge selon ses goûts, quand bien même il peut se tromper. Pour ce qui concerne la critique de SF, on sait bien que sa principale plaie est le système des copains, hérité du fandom, qui pousse à encenser des bouquins médiocres parce qu’on est pote avec son auteur. Et inversement.
Cela vous pose-t-il un problème de juger vos compères ?
Point du tout. On me juge bien, moi. Je n’oublierai jamais l’article haineux qu’a pondu, dans LE MONDE où il a brièvement tenu la rubrique SF, Emmanuel Jouanne au sujet de mon recueil Ne coupez pas ! Mais est-ce pire qu’être ignoré ? LE MONDE (enfin), sous la plume absente de Jacques Baudou, n’a pas écrit une ligne sur ce livre. Bon, fermons le ban, et oublions ces mouvements d’humeur…
AU SUJET DE QUELQUES ŒUVRES CLÉS
Attardons-nous sur quelques-uns de ses romans qui ont « compté ».
Les Hommes-Machines contre Gandahar (1969)
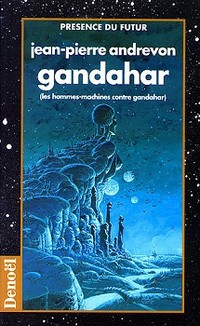
Ecrit en 1969, c’est votre premier livre. Comment considérez-vous ce titre aujourd’hui ?
Pas exactement mon premier car, juste avant, j’avais écrit dans la hâte et l’exaltation une sorte de récit qu’on pourrait étiqueter d’« autofiction », ou de « post-moderne » (avant la lettre), au sujet d’un Mai 68 fantasmé, qui tirait vers la SF (Après une révolution manquée). Mais c’était très foutraque et les rares éditeurs à qui je l’ai présenté n’en ont pas voulu, à juste titre je crois. Puis est venu Les Hommes-machines, pareillement rédigé en roue libre, mais dans une sorte d’état de grâce, tapé directement sur ma vieille Underwood de l’époque, et livré quasiment sans corrections. Une sorte de miracle que je ne m’explique toujours pas aujourd’hui : alors qu’en cas de réédition je reprends toujours mes textes pour les corriger avec un soin maniaque, parfois en les modifiant notablement, je n’ai jamais changé une virgule à ce roman.
Pourquoi avoir écrit ce livre à l’époque ?
A l’époque, ce n’était pas un roman que j’avais en tête, mais une bande dessinée. J’étais encore dans ma période graphique et, comme je ne vendais pas mes peintures, c’est vers la bd que je voulais me tourner. J’ai donc fait une dizaines de planches d’une composition très libre, en couleurs directes, que je suis allé présenter à Eric Losfeld, qui avait déjà publié Barbarella de Forest, un Druillet, un Pellaert, et s’apprêtait à éditer La Saga de Xam de Nicolas Devil. Je ne manquais pas d’air et, à côté de ces géants, je ne faisais pas le poids. Résultat des courses, Losfeld a (gentiment) refusé mon projet. Comme il était le seul éditeur sur la place à pouvoir éditer ce genre de bd, j’ai abandonné. Mais, nullement découragé, j’ai décidé de la traduire en roman et… voir plus haut.
Vous avez écrit des suites à cette histoire : Gandahar et l’oiseau monde (1997), Les Portes de Gandahar (1999), Cap sur Gandahar (1999), Les Rebelles de Gandahar (2002) et L’Exilé de Gandahar (2004). Pourquoi avoir repris la plume des années après pour lui donner une suite ?

J’avais dès le départ le projet d’écrire d’autres Gandahar, car je sentais confusément que je tenais là un univers à la fois original et qui me correspondait bien. Mais, comme trop souvent, le temps et les circonstances ont eu raison de ces louables intentions. J’avais à la fois intégré FICTION où je donnais moult nouvelles et critiques, et CHARLIE MENSUEL, où je rédigeais plusieurs rubriques et des scénarios pour Pichard. Sans oublier mes recueils, mes anthos, mes romans au Fleuve Noir. Donc Gandahar est passé à la trappe. Et puis, lorsque, vers 96, Denis Guiot a pris les rênes d’une collection de SF jeunesse chez Hachette et qu’il m’a demandé un manuscrit, cette vieille envie est remontée à la surface. De 70 ou 71 me restaient deux synopsis gandahariens : Gandahar et l’oiseau monde et Cap sur Gandahar, dont je me suis servi - les trois autres étant des créations. J’ajoute que, pour ce qui est de l’écriture, je n’ai jamais fait de différence entre les Gandahar étiquettés « jeunesse » et les adultes - avec, dans le premier cas, un peu de sexe en moins, sans doute.
Vous y dénoncez les dérives de la génétique. Que pensez-vous de cette science actuellement ? L’a-t-on domestiquée ou doit-on encore la craindre ?
Voilà une question estampillée 2007 au sujet d’un roman écrit en 1968 ! A l’époque, ma préoccupation de 68tard tenait plutôt à la mise en accusation de l’exercice du pouvoir. Le Métamorphe, dont le cerveau se sclérose parce qu’il est devenu trop vieux, c’est en réalité de Gaulle, grand homme certes en 1940 mais devenu, vingt-huit ans plus tard, un vieillard déconnecté de son temps… Ceci dit, que les lecteurs d’aujourd’hui voient dans Les Hommes-machines, à cause des Transformés, des références aux manipulations génétiques me plairait plutôt : cela prouverait que j’ai fait de la prospective sans le vouloir. C’est ainsi, en SF. On se trompe souvent et, s’il se trouve qu’on a raison, c’est souvent à l’insu de son plein gré. Plus sérieusement, par manque regrettable de vraies infos scientifiques au sujet des OGM, j’ai une opinion plutôt fluctuante. Pour le moins, je réclame le principe de précaution, soit des expériences en milieu confiné. Aussi, suis-je tout cœur avec les faucheurs de José Bové. Pour ce qui est de la culture des cellules-souches, je suis bien évidemment pour, car cela semble être la source de progrès remarquables, notamment dans l’éradication des maladies génétiques. Et puis il faut toujours être d’un avis opposé à celui de Bush !
Mais on pourrait dire également que les Hommes-Machines sont une symbolisation des nazis. Avez-vous vous voulu parler de cela dans ce roman ?
Exactement, c’était une autre partie du sous-texte : ce déferlement d’un ennemi au départ invincible, qui envahit un pays pacifique, massacrant et détruisant tout sur son passage, c’est clairement l’invasion nazie de 1940. D’ailleurs dans ma bande dessinée avortée, les robots portaient un casque semblable à celui des soldats allemands…
La Fée et le Géomètre (1981)
Prix de la science-fiction pour la jeunesse en 1982

Dans ce livre, vous dénoncez les ravages de la colonisation et de la technologie. Pensez-vous que les jeunes y soient sensibles ?
J’ai souvent eu l’occasion de discuter de ce livre lors de mon passage dans des classes. Et effectivement, il a toujours été compris et a recueilli de bons échos. Les jeunes, comme vous dites, ne sont pas si idiots que ça… Ceci dit, en l’écrivant, je n’avais pas spécialement l’intention de le faire éditer dans une collection jeunesse. Et puis le sort en a décidé autrement, ce qui n’a valu quelques petits problèmes (et quelques menues coupes) au sujet des passages sur les missionnaires et la religion. Mon but était en quelque sorte de mixer le génocide indien - j’ai mis dans la bouche du mage Marlin des fragments de discours du chef sioux Seattle, recueillis au XIXe siècle - et la mise en coupe réglée de l’Afrique. Pour moi, c’est un livre frère des Hommes-machines, qui obéit à la même structure et au même discours.
Mais vous êtes également optimiste dans ce livre en privilégiant par exemple la mixité des couples et la mobilisation des jeunes générations. Croyez-vous au changement grâce aux générations futures ?
La mondialisation n’a pas que des côtés négatifs et la mixité, ethnique autant que culturelle, peut être un ferment de compréhension, d’enrichissement mutuel, certainement. Il n’y qu’à voir ce qui, par delà les guerres, s’est passé entre les Xe et XIVe siècle entre chrétiens et musulmans. Mais, aujourd’hui, est-ce que je n’écrirais pas la fin de manière différente ? J’en ai bien peur, hélas…
Le travail du furet à l’intérieur du poulailler (1983)
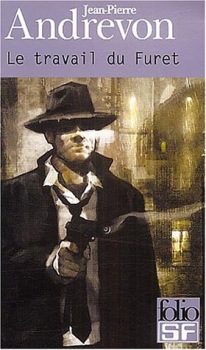
Racontez-nous la genèse de ce livre important dans votre carrière.
Au départ, c’est une nouvelle d’une dizaine de pages que j’avais donnée à Daniel Walther pour son anthologie de 1975 Les Soleils noirs d’Arcadie. Ce texte m’avait été inspiré par un série dessinée de Wolinski, Georges le tueur, qui paraissait dans HARA-KIRI, et où il était question d’un petit bonhomme dont le métier était, tout simplement, de tuer des gens. J’adore l’humour de Wolin, qui correspond au mien, j’adore le bonhomme (c’est d’ailleurs lui qui m’avait appelé à CHARLIE MENSUEL) et, comme de juste, je lui ai dédié la nouvelle. Mais je sentais que je n’avais pas exploité tous les développements dont le sujet était porteur et, cinq ou six ans plus tard, j’en ai fait un roman, que j’ai donné à J’ai Lu et non pas à Denoël, pour dire de ne pas mettre mes deux pieds dans le même sabot. Le roman a été édité fin 82, deux mois je crois après deux événements d’importance dissemblable : la sortie du roman de Michel Pagel, A l’aube au chant du tueur, qui exploitait le même sujet, et l’arrivée sur les écrans de Blade Runner, dont l’esthétique rejoint celle du Furet. On n’a pas manqué de m’accuser d’avoir copié l’un et l’autre, alors que l’écriture de mon roman était achevée à la mi-81. Encore ces histoires de concordances fortuites.
20 ans après, il est encore réédité, appréciez-vous toujours ce livre ?
Ce serait plutôt une question à poser à ses lecteurs… Mais il est de fait qu’il reste un de mes préférés, avec Tout à la main et Le monde enfin, oui. Si je peux en une phrase de permettre d’être le critique de moi-même (signé Denis Philippe), je dirais que j’ai réussi une bonne adéquation entre le sujet et le langage.
Et le public comment le reçoit-il ?
Réponse avec la question suivante, que me posent souvent mes lecteurs…
Etes-vous toujours d’accord avec l’idée du livre, à savoir, réguler la surpopulation par une élimination journalière de la population ?
Ah ! C’est un roman, hein… pas un programme politique. Mais honnêtement, c’est aussi un fantasme. La Terre, aujourd’hui déjà, compte trop d’habitants pour ses ressources limitées, alors il faut faire quoi ? L’Afrique, malgré les guerres, la famine, la sécheresse, le sida, va doubler sa population d’ici 2050. Il faut faire quoi ? Le but avoué de l’Inde est de dépasser la population chinoise au même horizon. Il faut faire quoi ? Ces jours-ci, on se félicite dans tous les médias que le taux de fertilité des Françaises soit le plus fort d’Europe. Il faut faire quoi ? Peut-être les désordres climatiques vont-ils régler ça sans faire de détails, comme je l’ai évoqué dans Marée descendante ou De vagues et de brume…
Une BD a été tirée du livre, racontez-nous ça.
J’ai reçu un jour un mail d’un jeune dessinateur qui sortait de l’école d’Angoulême et qui, ayant aimé mon roman, désirait en faire une adaptation. C’était Afif Khaled. Il m’avait présenté des travaux préparatoires très aboutis techniquement mais qui figuraient les humains sous la forme d’animaux anthropomorphiques, des singes, des fauves ; je trouvais que ça ne collait pas et puis il y avait déjà Blacksat. Donc Afif a remis son travail en chantier en même temps que, pour nous faire la main, je lui donnais deux scénarios de bandes courtes. L’une a été publiée dans un magazine qui n’a vécu que deux numéros, KOG, l’autre est restée inédite. Ensuite, nous avons présenté à divers éditeurs les cinq premières planches du Furet qu’Afif avait faites d’après mon découpage. C’est Soleil qui a remporté le cocotier. Le reste… il n’y a qu’à s’en mettre plein les yeux. Il ira loin, ce petit !
La BD est-elle différente du roman ? En quoi ?
Dès le départ, j’avais prévu de faire une mini-série de trois albums, ce qui me semblait raisonnable pour rendre la substantifique moelle du roman. Naturellement, j’ai tout recentré sur l’action, ce qui est le moins pour une bd. Et j’ai apporté deux modifications principales : d’une part, le Furet rencontre Jos au cours d’une péripétie où il lui sauve la vie, ce qui me semblait plus fort dramatiquement que dans le livre, où ils se connaissent déjà ; deuxièmement, j’ai introduit (tome 2) un flash-back sur le passé de mon héros : un ancien militaire qui, lors d’une énième guerre moyen-orientale, a dû tuer la femme qu’il aimait. Ce qui épaississait le portrait, en quelque sorte.
Le roman a été également adapté à la télévision. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Comme pour la bd (ou pour Gandahar), j’ai été contacté par Antenne 2 qui désirait réaliser une adaptation du roman sous forme d’un téléfilm autonome. La comparaison s’arrête là, car je n’ai en aucune façon participé à l’élaboration du projet. J’ai même visionné le film en même temps que le public, lors de sa première diffusion, début 94, sur la 2. Je dois dire que j’ai été cruellement déçu. D’abord par l’aspect fauché de l’ensemble - le téléfilm a été tourné à Bucarest, avec une poignée de figurants et dans des décors contemporains, alors que je rêvais de Blade Runner ! D’autre part, je n’aime pas le comédien qui incarne mon Furet, un gringalet qui fait le clown, alors que je voyais Delon au temps du Samouraï… Mais peut-on s’attendre autre chose de la télé ? J’ajoute que j’ai par la suite rencontré le réalisateur, Bruno Gantillon, qui a admis certaines de mes remarques et est devenu un excellent ami. Nous avons périodiquement des velléités d’un retour au Furet, ou à son univers, sous une forme ou une autre, mais jusqu’à présent sans suite…
Sukran (1989)
Grand Prix de l’Imaginaire

Encore et toujours des problèmes écologiques (la montée des mers, la noyade de Marseille, les animaux modifiés…). Ce sont des thèmes ultra-présents dans votre œuvre.
Puis-je évoquer d’abord, en quelques phrases, l’origine du roman ? Comme Gandahar, ce fut au départ une bd, celle-ci réellement matérialisée, du moins en partie, sous la forme d’un album publié chez Glénat : Neurones trafic. Je n’en étais pas seul responsable, puisque le dessin est signé Véronik, une dessinatrice suisse que j’avais rencontrée grâce à Kesselring, et avec qui j’avais publié un précédent album avec le même héros : Matricule 45000. Ce héros, Fabien, était un soldat perdu tombé dans la clochardisation après… une guerre moyen-orientale ! En somme, il pourrait être le Furet plus jeune. Je souhaitais en faire un personnage récurrent, mais une mauvaise entente avec Véronik et la tout aussi mauvaise volonté de l’éditeur ont voulu que la bande s’interrompe avec le tome un, alors qu’elle était prévue en deux volumes. Qu’ai-je fait ? Comme pour Gandahar, je ne me suis pas découragé et l’ai transformée en roman. Et, comme pour le Furet, j’ai introduit un récit très polar dans un décor légèrement futuriste, un mixage que j’adore et qui vient sans doute de mon admiration de jeunesse pour Les Cavernes d’acier d’Asimov (tiens ! encore un bouquin fondateur que j’ai oublié…). Quant à la montée des eaux… vous voyez qu’il y a vingt ans, on savait déjà tout des conséquences de l’effet de serre.
Sukran présente aussi une critique de la société (les nantis qui ont accès aux loisirs, le racisme…). Ne sont-ce pas là des problèmes universels et intemporels ?
Et des problématiques surtout présentes dans le polar. Ce pourquoi j’aurais aimé que ce roman soit publié en Série Noire. Mais il a été refusé par Raynal, alors il est sorti en PdF. Mais, pour moi, c’est vraiment un thriller proche de ce qui a été publié sous le label « Néopolar » avec, je l’espère, une légère imprégnation Manchette - autre auteur dont je me sens très proche, autre ami disparu trop tôt, et que je suis heureux de citer à cette occasion.
L’œil derrière l’épaule (2001)
Prix du Roman d’Aventure

La sectarisation est pointée dans ce livre. Avez-vous peur de cet aspect des choses ?
Je n’ai peur (ce qui est manière de parler : je suis d’un naturel extrêmement courageux, comme le chevalier Bayard qui est mon voisin isérois) que de ce qui risque de m’atteindre. Et comme je suis imperméable à toute influence sectaire… Non, je me suis plutôt intéressé ici au phénomène des résidences protégées, qui fleurissent aux USA. Pas les cités-bunker qu’aime tant Brussolo, plutôt les Community Associations, qui présentent le visage inverse. Le plein air, un aspect aimable, des villages coquets où tout le monde se connaît, comme la cité créée par Tim Burton pour Edward aux mains d’argent.… C’était ce que je voulais mettre en lumière : une emprise insidieuse, qui ne se dévoile pas tout de suite. J’aurais pu, j’aurais dû sans doute y ajouter une composante religieuse, mais je suis si éloigné de la religion que me sentais incapable de créer des personnages et des comportements intégristes convaincants. D’un autre côté, la religion aurait accentué l’ancrage américain ; ainsi, le récit est plus universel. D’ailleurs, alors que j’en étais au synopsis, ma communauté se trouvait en France.
Avez-vous peur que les gens perdent leur esprit critique, qu’ils soient happés par la société ?
Est-ce que ce n’est pas le cas ? Tout en étant conscient que cela vient précisément d’un sentiment de peur. Peur du lendemain, peur du changement, peur des étrangers… C’est ainsi qu’on se réfugie dans la religion, à l’intérieur d’une secte - à moins que l’on se replie sur soi-même.
Le roman se rapproche un peu d’un classique comme 1984. Y avez-vous pensé en écrivant ce livre ?
Non. C’est un suspense très réaliste, très éloigné de la science-fiction. Contrairement à Sukran, il fait vraiment partie du versant polar de mon travail. Il est vrai cependant que j’y ai déversé des hantises qui me correspondent : la claustrophobie, le rejet de toute contrainte, fusse-t-elle faussement amicale, la hantise des « amis-qui-vous-veulent-du-bien » et viennent vous emmerder… Bon, d’accord : ma misanthropie, si vous voulez.
Le Village qui dort (2001)
Prix Masterton 2002
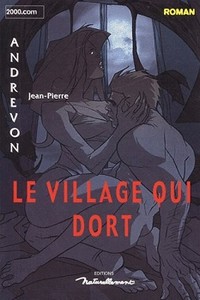
Un roman fantastique. Comment considérez-vous le fantastique ?
Vaste question ! J’ai déclaré une fois (ou plusieurs) que si la SF, c’était Marx, le fantastique, c’était Freud. Et qu’il était la littérature de l’intimisme alors que la SF était celle du collectif. On pourrait trouver dix autres définitions, dix autres motivations (explorer les peurs de l’enfance, par exemple), mais je voudrais surtout déclarer haut et fort que, contrairement à ce qu’on veut bien faire semblant de croire à mon sujet, le fantastique m’est aussi indispensable que la SF, tant comme lecteur que comme pratiquant. Rappelez-vous les « Angoisse » que je dévorais à 15 ans ! En fait, mon troisième roman publié, après Les Hommes-machines et La Guerre des Gruulls était un roman fantastique : Un froid mortel… dans la collection « Angoisse », que j’intégrais ainsi quinze ans après en avoir fait mes délices.
Le thème des vampires est célèbre, vous l’utilisez ici teinté de sexualité. Vous aimez les vampires ?
Heu… pas de trop près, quand même ! En fait, j’ai rarement abordé le thème du vampirisme, ou alors de manière très détournée (La maison d’Emilie), tout simplement parce que 500 000 auteurs l’ont fait. Pour ce qui est du Village qui dort, j’aurais aussi bien pu évoquer des loups-garous ou tout autre sorte de communauté secrète et fermée plus ou moins monstrueuse. Ce qui m’amène à dire que ce roman est bien plus proche qu’on pourrait l’imaginer de L’œil derrière l’épaule, car le vrai sujet en est l’enfermement - qui exprime à nouveau ma claustrophobie.
Le sexe est finalement peu utilisé en Imaginaire. L’Imaginaire est-il asexué ?
C’est un peu un cliché, non ? Ou une question qui a trente ans de retard ? Stephen King n’est pas particulièrement timide en matière de sexe, ni un auteur un peu oublié comme John Boyd. Poppy Z. Brite en fait un usage immodéré, même s’il est mêlé à la souffrance et à l’anormalité, dimensions que j’ai toujours évitées, détestant l’alliance Eros/Thanatos (L’Empire des sens). Et que dire de Daniel Walther ? Même un écrivain aussi distingué que Ballard ne fait pas l’impasse sur le Q. Ceci dit, il en est du sexe comme de la politique ou de l’écologie. Les écrivains pour qui c’est quantité négligeable l’ignorent, ceux pour qui c’est le sel de la vie l’abordent frontalement (si je peux dire…)
Peut-être un peu moins « révolutionnaire » comme livre, un peu moins de revendication non ? Qu’avez vous voulu faire avec ce titre ?
Du fantastique horrifique, pardi ! Où j’exprime les fantasmes intimes : me perdre dans un endroit inconnu, être prisonnier de quelque chose ou quelqu’un. Ce livre (issu, comme beaucoup d’autres, d’un rêve) se situe dans la droite ligne de mes « Angoisse » - une collection que j’aurais aimé voir se perpétuer jusqu’à aujourd’hui, et où j’aurais continué à écrire. Je dois avoir vingt ou trente synopsis du genre dans mes tiroirs. Il y a un éditeur dans la salle ?
Le Monde enfin (2006)
Prix Julia Verlanger
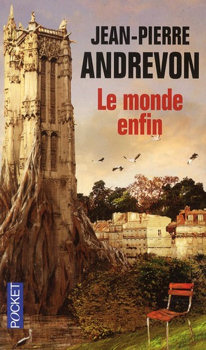
Une série de nouvelles raconte la fin de l’humanité, dont la première date de 1975. Comment s’est écrite cette vaste saga ?
Il se trouve que, en 1975, j’avais écrit une nouvelle déjà titrée Le Monde enfin, pour le recueil collectif Utopies 75, qui comprenait quatre longs textes, publiés dans la collection « Ailleurs Demain ». Dans cette nouvelle, la race humaine s’était éteinte sans que la cause en soit précisée et un vieil homme de 80 ans parcourait la France à cheval, rencontrait des petites communautés ou des isolés, les dernières branches de l’humanité déclinantes. Par la suite, j’ai écrit d’autres nouvelles qui pouvaient se rattacher à ce décor - ce monde vide, qui retourne à la nature et aux animaux. Je pense notamment à La Tigresse de Malaisie, l’histoire d’une femme de cinquante ans qui se désespère de mettre un enfant au monde et voit s’approcher l’âge de la ménopause. Un texte paru dans mon recueil PdF Il faudra bien se résoudre à mourir seul - tout un programme…
Vous avez écrit ces textes entre 1975 et 2003. Aviez-vous déjà en tête de les relier et d’en faire un seul gros volume ?
Dans les années 90, j’avais quatre ou cinq textes, écrits sur l’espace d’une vingtaine d’années, qui rejoignaient ces thèmes d’une fin du monde douce et d’un renouveau écologique de la Terre. L’idée m’est alors venue (je crois qu’elle m’a été soufflée par Gilles Dumay) de les regrouper dans un recueil. Mais pourquoi l’arrêter avec des récits déjà écrits ? J’ai alors décidé de boucher les trous, d’organiser le recueil en une saga plus ordonnée, avec des personnages récurrents J’ai donc réécrit les nouvelles existantes pour les faire coller avec les nouveaux textes que je pondais à mesure. Et j’ai lié le tout avec le texte liminaire, scindée en une douzaine de parties, pour en faire une sorte de respiration. Donc presque 30 ans, oui… ce qui est sans doute assez rare pour être souligné.
Pourquoi avoir écrit sur ce thème ? Quel est votre message ?
Depuis ma première nouvelle publiée, La Réserve, je crois avoir montré que le thème m’obsédait. Pourquoi ? Parce que c’est LE thème, sans doute. La fin du monde ou la fin de l’humanité arrivera bien un jour. De même que notre propre mort, donc elle est la synecdoque. On n’invente rien en science-fiction, on essaie seulement, vu de notre présent, de décrypter le futur. Les pandémies, il y en a toujours eu : la grippe espagnole a tué plus de monde que la Première Guerre mondiale. La Grande Peste Noire au Moyen-âge a abattu le tiers de la population européenne… Il n’y a là rien de nouveau et ce qui s’est produit peut très bien se reproduire. Quand j’ai commencé à structurer Le Monde enfin, je pensais à l’encéphalite spongiforme. Puis le fantasme de la grippe aviaire est arrivé. Il y a toujours une épidémie dans l’air. Ou tout autre cause à notre fin programmée. La Terre a vécu cinq grandes extinctions, dont celle qui, il y a 65 millions d’années, a vu la fin des dinosaures. On sait que nous sommes en train de vivre une sixième extinction, plus diffuse, qui peut nous paraître lente, mais en réalité très rapide géologiquement, qui est en train de toucher les animaux et la flore - des centaines d’espèces disparaissant chaque année. Demain l’Homme ? Alors pas de message, non. Seulement une constatation.
Considérez-vous ce livre comme étant le meilleur de ce que vous avez écrit ?
J’ai pu déclarer, avec une suffisance certaine, que c’était mon grand œuvre, oui. Il unit et synthétise des thèmes que j’ai toujours traités : l’écologie, la fin du monde, l’amour des animaux. De même qu’il est le creuset de toutes mes angoisses : la dégradation de la planète, la pollution généralisée, la fin des ressources, la disparition progressive des espèces animales et végétales. Quant au résultat, il est vrai que l’accueil aussi bien critique que populaire me pousserait à me rengorger. Mais ce n’est qu’un livre, hein…
Doit-on considérer ce livre comme optimiste ou pessimiste ?
C’est en tout cas le fantasme d’un écologisme radical - que je ne souhaite pas voir se réaliser, évidemment. Quoi que, dirait Raymond Devos. En outre, il rejoint certaines images et lectures d’enfance : le paradis terrestre, Adam et Eve vivant en paix au milieu des animaux, Robinson Crusoe, Tarzan le seigneur de la jungle avec ses grands singes et ses éléphants (mais aussi avec Jane, quand même)… Disons que c’est le rêve optimiste d’un pessimiste à tout crin.
Ce livre, par rapport à ce que vous écriviez il y a 30 ans, est peut-être moins « féroce », moins « contestataire », plus en paix avec vous-même. En comparant ce livre-ci à ceux de vos débuts, est-ce que l’écrivain, l’homme Andrevon, a changé, évolué ?
Je prétends ne pas changer, je change forcément un peu… Certes pas pour ce qui est de l’essentiel. Je ne voudrais pas non plus penser, ou donner à penser que je me suis assagi. Je gueule toujours autant contre ce qui m’indigne, que je le fasse en mon nom personnel ou comme membres des multiples associations dont je fais partie, que ce soit par écrit ou dans des manifs. Alors quoi ? C’est une question de thématique, uniquement : une fin douce est aussi raisonnablement prévisible qu’une fin dure (conflit nucléaire). Ayant choisi de traiter d’une fin douce, l’écriture l’est forcément aussi.
En 1980, vous avez fait la liste de vos cinq romans SF préférés :
* Les chroniques martiennes de Ray Bradbury (Denoël) :
Parce que c’est une superbe remise en cause du colonialisme et de l’anthropomorphisme, mais faite en douceur et en poésie.
* Le diable l’emporte de René Barjavel (Denoël) :
Parce que c’est le comble de la noirceur sur un sujet qui a fait des petits (la der des der), mais avec plein de tendresse autour.
* Tous à Zanzibar de John Brunner (Laffont) :
Parce que c’est le premier panorama exhaustif de tout ce qui nous attend (pollution, surpopulation), sexe et violence en prime.
* Malevil de Robert Merle (Gallimard) :
Parce que sur le sujet rebattu de la fin du monde et du recommencement, c’est beau comme un camion.
* Le fleuve de l’éternité (et ses suites) de Philip José Farmer (Laffont) :
Parce que ça exprime nos fantasmes les plus forts (immortalité, jeunesse éternelle) au sein d’une saga à vous couper le souffle.
Sont-ils toujours les mêmes ? En rajouteriez-vous ?
C’est une bonne liste. D’ailleurs j’ai cité déjà trois de ces titres. Je m’étonne ne pas y avoir inclus La Guerre des monde et Niourk, et aussi un Silverberg. Mais lequel ? Les Monades urbaines ou L’Oreille interne, certainement.
N’oublions pas qu’Andrevon a commencé par dessiner. Il a illustré des dizaines d’ouvrages et peint depuis toujours. Interrogeons-le.
Illustrations
Vous êtes aussi peintre et dessinateur. Pouvez-vous nous parler un peu plus précisément de ces diverses activités ?
Elles sont scindées en diverses disciplines. Peintre, j’ai peu à peu abandonné la stylisation vaguement cubiste de mes début (Braque-Picasso) pour un réalisme fantastique qui n’est pas tout à fait de l’hyperréalisme, mais où je rejoins tout de même plus étroitement mes préoccupations d’écrivain. Ainsi, je suis en train de travailler (à vitesse d’escargot) sur une série de toiles où je représente divers quartiers ou bâtiments de Grenoble ayant subi la dégradation du temps : noyés ou ensablés. Des paysages sans âme qui vive - donc effectivement très proches du Monde enfin qu’ils pourraient illustrer (on peut voir certaines de ces toiles sur mon site). Dessinateur, je m’amuse toujours à faire des croquis rapides à l’encre de Chine, dans le style dessins de presse. A mesure, je les édite en petits albums : Les Chats, Les Eléphants, Hou lala, qu’est-ce que je tiens ce matin ! (site !). La bande dessinée ? Vous savez ce qu’il en est : je l’ai abandonnée à plus talentueux que moi, me bornant à être scénariste. Tout de même, j’ai tenté, il y a une dizaine d’années, d’adapter, texte et dessins, Niourk, avec l’assentiment et les encouragements de Stefan Wul, à qui j’ai fait voir mes planches. Il en existe une douzaine, que j’ai montrées ici et là, sans parvenir à trouver un éditeur. J’ai fini par laisser tomber. Définitivement ? Je ne sais pas… Par contre, j’ai à peu près complètement abandonné l’illustration, faute de demandes. Quand même, j’ai dû faire une vingtaine de couvertures et parfois les illustrations intérieures de certains de mes bouquins jeunesse.
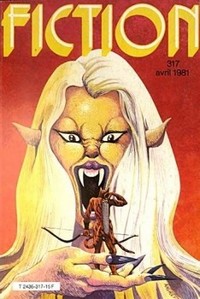
Quelle est la différence entre écrire et dessiner ?
Elle est essentiellement technique. Ce sont deux arts différents. Mais en définitive, ce sont toujours les mêmes organes qui travaillent : le cerveau qui conçoit, l’œil qui surveille, la main qui exécute. J’ai certes commencé à dessiner avant d’écrire, mais de peu d’années. Et toujours dans une optique résolument narrative. Entre douze et dix-huit ans approximativement, je me suis amusé à reproduire, aux encres de couleurs, sous la forme de dioramas, les principales scènes des films d’aventures dont je me gavais : des attaques d’Indiens, des duels de mousquetaires, des combats de gladiateurs… Déjà des fragments de bandes dessinées. Quant aux dessins que je faisais dans LA GUEULE OUVERTE, ils étaient bien évidemment écologiques. Bref tout converge.
Andrevon a utilisé divers pseudonymes durant sa carrière, le plus célèbre étant Alphonse Brutsche.
Pseudos
Pourquoi avoir écrit sous pseudonyme ?
Pour la seule et unique raison que mon premier roman, publié chez Denoël, comportait par contrat une clause alors en usage mais aujourd’hui tombée en désuétude, celle du droit de préférence portant sur cinq ouvrages. M’étant mis à écrire presque immédiatement, et parallèlement, pour le Fleuve, je devais trouver un autre nom. J’ai donc créé « Alphonse Brutsche » (Brutsche étant le patronyme de la lignée ascendante de ma grand-mère, d’origine alsacienne) en réaction contre la mode en usage au Fleuve voulant que l’on adopte un nom aux consonances américaines ou allemandes (Kurt Steiner, Stefan Wul). Alphonse, ça sonnait très bien ! Je l’ai abandonné dès que le masque eût été arraché par Jacques Sadoul dans un de ses bouquins, sans réaction notable de Denoël. Contrairement à ce qu’on a longtemps voulu croire, je n’ai jamais cultivé, pas plus que je n’aime ou approuve ce système des pseudos, n’ayant rien à cacher et assumant ce que je fais. J’ai simplement, un temps assez court, adopté un autre pseudo pour mes critiques dans FICTION : Denis Philippe, que je partageais d’ailleurs avec George Barlow et Martial-Pierre Colson. Là encore, ce n’était pas pour taper dans l’ombre sur des confrères, mais sur la demande d’Alain Dorémieux, parce qu’à une certaine époque j’écrivais vraiment beaucoup pour FICTION et qu’un notable énervement s’était fait jour chez certains lecteurs, qui trouvaient qu’Andrevon prenait tout de même un peu trop de place dans la revue…
Revenons sur Alphonse Brutsche. Quelles sont les différences avec vos textes signés Andrevon ?
 Y en a-t-il ? Si c’est le cas, c’est plus de structure que de facture, je crois. J’ai très vite donné à Denoël presque exclusivement des recueils de nouvelles, alors que mes romans étaient plutôt destinés au Fleuve. De plus, je me suis vite mis à écrire pour la collection « Angoisse » un genre de romans qu’il aurait été impossible de publier en « Présence ».
Y en a-t-il ? Si c’est le cas, c’est plus de structure que de facture, je crois. J’ai très vite donné à Denoël presque exclusivement des recueils de nouvelles, alors que mes romans étaient plutôt destinés au Fleuve. De plus, je me suis vite mis à écrire pour la collection « Angoisse » un genre de romans qu’il aurait été impossible de publier en « Présence ».
La différence, si différence il y a, vient de là, et pas d’un soi-disant déficit d’écriture pour ce qui concerne le Fleuve, car je sens bien que c’est ce que votre question sous-entend. Pour double preuve : Les Hommes-machines a d’abord été présenté au Fleuve, où François Richard l’a refusé, me disant qu’il aimerait bien, cependant, lire d’autres romans de moi. Je l’ai alors fait lire chez Denoël en second choix, où il a été accepté. Quelques années plus tard, le Fleuve m’a refusé Le temps des grandes chasses. J’en ai fait une version allongée, l’ai présentée à Robert Kanters qui l’a pris. Dont acte ?
Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, Andrevon a concocté quelques belles anthologies.
Anthologiste
Qu’est-ce que votre travail en tant qu’anthologiste vous a apporté ?
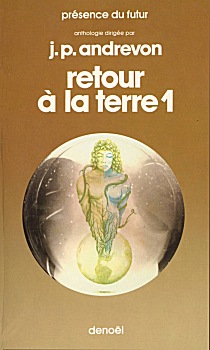 Qu’est-ce qu’il a apporté à ceux que j’ai publiés, vous voulez dire ? Allons, je plaisante… Ces anthologies étaient surtout une composante de l’air du temps, en fait : les années 70, la contestation, le désir de refaire le monde, au moins sur le terrain de la SF, et l’émergence de ce qu’on pu appeler « la jeune science-fiction politique française », qui a fait grincer bien des dentiers. En gros, dans ces années-là, la SF se divisait en deux groupes : la droite (en gros, le Fleuve Noir), et la gauche (extrême parfois) : nous autres. Tous copains, tous solidaires - je plaisante encore un peu, mais à peine. Nous lancions des manifestes, les anthologies en faisaient partie. Sans doute ai-je amorcé le mouvement en 1975 avec Daniel Walther (moi le premier Retour à la Terre, lui Les Soleil noirs d’Arcadie), mais il aurait pareillement fait son chemin sans moi. Ma « position de force » (je tiens aux guillemets) chez Denoël, où j’étais « l’auteur-vedette français » (je tiens aux guillemets) m’a simplement permis, en introduisant mes anthos en « Présence du Futur », de leur donner un peu plus de poids éditorial. Pour le reste… publier des copains, des gens que j’appréciais et apprécie toujours, c’était un plaisir.
Qu’est-ce qu’il a apporté à ceux que j’ai publiés, vous voulez dire ? Allons, je plaisante… Ces anthologies étaient surtout une composante de l’air du temps, en fait : les années 70, la contestation, le désir de refaire le monde, au moins sur le terrain de la SF, et l’émergence de ce qu’on pu appeler « la jeune science-fiction politique française », qui a fait grincer bien des dentiers. En gros, dans ces années-là, la SF se divisait en deux groupes : la droite (en gros, le Fleuve Noir), et la gauche (extrême parfois) : nous autres. Tous copains, tous solidaires - je plaisante encore un peu, mais à peine. Nous lancions des manifestes, les anthologies en faisaient partie. Sans doute ai-je amorcé le mouvement en 1975 avec Daniel Walther (moi le premier Retour à la Terre, lui Les Soleil noirs d’Arcadie), mais il aurait pareillement fait son chemin sans moi. Ma « position de force » (je tiens aux guillemets) chez Denoël, où j’étais « l’auteur-vedette français » (je tiens aux guillemets) m’a simplement permis, en introduisant mes anthos en « Présence du Futur », de leur donner un peu plus de poids éditorial. Pour le reste… publier des copains, des gens que j’appréciais et apprécie toujours, c’était un plaisir.
Avez-vous découvert des auteurs qui, un peu grâce à vous, ont percé ?
Il faudrait leur demander ! Honnêtement, je ne pense pas. J’ai été le premier (L’Oreille contre les murs), avec Philippe Curval (in Futurs au présent), à publier professionnellement Brussolo. Son envol tient-il à nous ? Bien évidemment pas - seulement à son talent, considérable. Par contre, j’ai essayé de pousser mon ami grenoblois George Barlow qui n’a jamais réussi à publier un seul ouvrage, hormis ses Livres d’Or. Il me reste quelques plaisirs : avoir pu attirer B. R. Bruss ou avoir accueilli, pour un de ses très rares textes de fiction, Daniel Phi (l’excellent Un si bel I.P.M.)
Quelle est l’anthologie dont vous êtes le plus fier ?
Ne parlons pas de fierté, terme qui ne fait partie de mon vocabulaire… Mais le double volume que j’ai pris le plus de passion à réaliser, ce sont les deux tomes de Compagnons en terre étrangère. Je n’avais rien inventé puisque je copiais sans vergogne Harlan Ellison. Mais c’était quand même, en fait de travaux collectifs, ma tentative la plus originale - qui n’a d’ailleurs été rééditée par personne. Ecrire en commun avec un certain nombre d’auteurs que j’appréciais humainement et comme auteur (citons un seul nom : Christine Renard) fut un challenge à la fois artistique et affectif que j’ai mené avec une exaltation toute particulière…
Quelle est l’anthologie que vous aimeriez réaliser ?
 Que j’aurais aimé réaliser, vous voulez dire ! Le tome 3 de Compagnons, puisqu’il me restait un certains nombres d’auteurs avec qui j’aurais aimé accoucher de bébés communs : Pelot, Wintrebert, Hubert entre autres. Mais Elisabeth Gilles a jugé que deux, c’était déjà bien assez… Une autre antho, que j’avais envisagée en partenariat avec mon ami Henri Gougaud, concernait la fin du monde. 13 fins du monde différentes, vue par 13 auteurs. J’avais écrit la mienne : la version nouvelle de Tout à la main et reçu une demi-douzaine de textes, que j’ai fait lire à Elisabeth (il y avait un Jeury et un Christin, je ne souviens plus des autres textes). Mais elle n’a pas trouvé le résultat à la hauteur de « Présence » (elle détestait Tout à la main, qui a par la suite été publié dans FICTION). Nous avions déjà largement entamé les années 80, le reflux commençait. J’ai laissé tomber les anthologies. Et n’y reviendrai pas…
Que j’aurais aimé réaliser, vous voulez dire ! Le tome 3 de Compagnons, puisqu’il me restait un certains nombres d’auteurs avec qui j’aurais aimé accoucher de bébés communs : Pelot, Wintrebert, Hubert entre autres. Mais Elisabeth Gilles a jugé que deux, c’était déjà bien assez… Une autre antho, que j’avais envisagée en partenariat avec mon ami Henri Gougaud, concernait la fin du monde. 13 fins du monde différentes, vue par 13 auteurs. J’avais écrit la mienne : la version nouvelle de Tout à la main et reçu une demi-douzaine de textes, que j’ai fait lire à Elisabeth (il y avait un Jeury et un Christin, je ne souviens plus des autres textes). Mais elle n’a pas trouvé le résultat à la hauteur de « Présence » (elle détestait Tout à la main, qui a par la suite été publié dans FICTION). Nous avions déjà largement entamé les années 80, le reflux commençait. J’ai laissé tomber les anthologies. Et n’y reviendrai pas…
Jean-Pierre Andrevon est un homme passionné. Cela se sent dans ses interviews, dans ses écrits, dans ses tableaux. Nous l’avons interrogé sur deux grandes passions : le cinéma et l’écologie.
PASSIONS
Cinéma
Vous êtes également un passionné de cinéma. Pourquoi aimez-vous autant le grand écran ?
C’est encore une passion qui remonte à l’enfance. Pendant la guerre, l’occupation, il n’était pas question de cinéma. J’étais bien jeune, et puis nos fréquents séjours familiaux à la campagne l’interdisaient. J’ai dû commencer à fréquenter les salles, avec ma mère, en 1945. Une période qui correspondait au déferlement sur les écrans des films américains, interdits depuis 1940. J’ai ainsi pu voir, en vrac, Le Dictateur de Chaplin, les Tarzan avec Johnny Weissmuller, le Robin des bois de Michael Curtiz, des tas de western où j’ai vite su repérer, au générique, la signature de John Ford ou de Raoul Walsh. Et puis cette merveille kitch qu’est Tumak fils de la jungle (One million B.C.) de Al Roach père et fils, film de préhistoire hautement fantaisiste où les dinosaures sont des varans, des iguanes, des crocodiles grimés. Toutes ces images qui bougeaient ! Toutes ces aventures extraordinaires ! C’était, pour l’enfant solitaire que j’étais, ma caverne d’Ali-Baba, mon château de la Belle au Bois dormant. Vite, vers dix-onze ans, j’ai commencé à aller au cinéma tout seul, chaque jeudi après-midi. Quel est le premier film de SF que j’ai pu voir ? Je ne me souviens pas mais, logiquement, ce devait être Destination lune d’Irving Pichell, puisque sorti en 1950, après une décennie de vaches maigres. Maintenant, je dirais que le ciné concentre tous les autres arts, littérature, théâtre, peinture, musique… Mais comment rendre compte de la magie ?
Quel est votre film de SF préféré ?
Sans hésitation, 2001, l’odyssée de l’espace.

Quel est votre film hors SF préféré ?
C’est déjà plus difficile. Mais je vais faire un effort : disons Le Crime de monsieur Lange, puisque réalisé par Jean Renoir, un de mes cinéastes favoris, avec Jacques Prévert au scénario - leur unique collaboration. Mais Vertigo est bien près, avec une demi-douzaine d’autres Hitchcock de sa grande période.
N’avez-vous jamais été tenté par la réalisation vous-même ?
Mais je l’ai fait ! Puisque j’ai réalisé deux courts-métrages et demi. Le premier, inachevé, en 1967, portait sur l’avortement, un sujet à l’époque brûlant. Mais il n’a pas été monté et la pellicule a été perdue. En 1971, j’ai tourné Nul n’y survivra (16 mn., 20 mn., noir et blanc), une histoire de fausse alerte atomique qui pousse une famille effrayée au suicide. George Barlow tenait le principal rôle masculin. J’ai par la suite transposé ce métrage en une nouvelle incluse dans mon recueil Neutron. Enfin, de manière un peu plus professionnelle, j’ai réalisé en 1976-77 Ce jour-là, sur la torture, avec la participation de réfugiés chiliens. Mais avec le recul, je ne l’aime guère. Ces deux courts-métrages sont passés dans des festivals, et même lors de la convention de Rambouillet, en 1980. Je me suis arrêté là. Pour quelqu’un qui rêverait d’être Spielberg, ce n’était pas aller bien loin. Pour une fois, j’ai manqué d’énergie, d’initiative, d’esprit de suite.
Votre livre Gandahar a été porté au cinéma. Avez-vous participé à son élaboration ?
Non. J’ai reçu, en 1973, de René Laloux, dont je connaissais La Planète sauvage, un petit mot manuscrit où il me demandait humblement si j’acceptais qu’il porte mon roman à l’écran, sous la forme d’un nouveau film d’animation de long métrage. Si j’acceptais ! Nous nous sommes rapidement rencontrés, mais j’ai vite constaté qu’il n’avait aucunement l’intention de me faire participer à l’aventure (je lui avais naturellement montré mes planches…) L’essentiel était qu’il eût l’intention de confier le dessin à Caza, qui était pour moi le meilleur choix. Mais ensuite, pour des raison de budget à réunir, l’affaire a traîné, quinze ans exactement, puisque, entre-temps, René a réalisé Les Maîtres du temps, et que Gandahar n’est sorti qu’en 88. La fabrication s’est déroulée en Corée du Nord, à l’époque encore accessible, et possédant les studios les moins chers au monde pour ce que était de l’animation. Selon Philippe Clerc, l’adjoint de Laloux, qui est resté un an et demi à Pion-Yang, ce fut à la fois cocasse et tragique ; ce qu’il raconte dans le bonus du DVD, enfin édité l’an dernier.
Comment trouvez-vous le résultat ?
Bien ! Avec, c’est inévitable, des critiques de détails portant sur l’animation, un peu trop raide, et quelques silhouettes, notamment celle du Sorn, rouge vif dans mes planches, une sorte de Godzilla selon Roland Emmerich, alors que, dans le film, c’est un dinosaure grisâtre et pataud. Mais l’essentiel est que ce film existe, un des trois longs-métrages tournés par Laloux qui, par la suite, fatigué par trop d’obstacle, s’est retiré. Lui aussi, je suis content de l’avoir connu...
Il paraît que vous bossez sur un énorme dictionnaire encyclopédique du cinéma. Pourriez-vous nous en dire plus ?
C’est un projet qui me titillait derrière l’occiput depuis longtemps. D’abord à cause de mon amour pour le cinéma, fantastique en particulier, et puis parce qu’il n’existe rien de tel en France. Il y a environ deux ans, un éditeur s’est montré intéressé, en l’occurrence Thierry Steff, autrefois à Dreamland, et qui est en train de lancer une nouvelle maison d’édition consacrée au cinéma. Alors je me suis lancé. En compagnie de deux seconds précieux, Bernard Médioni et Pierre Gires, tous deux rédacteurs à L’ÉCRAN FANTASTIQUE, et sous l’œil paternel d’Alain Schlockoff, rédacteur en chef de la revue. Mais qu’il soit bien entendu que j’écrirai moi-même entre 80 et 85 % du texte total. Le titre que j’aimerais lui voir aborder :
1896-2007 : 111 ans de films fantastiqueS et de science-fiction
L’ouvrage devant être (en principe) achevé fin 2007 pour une parution fin 2008, vous comprendrez que le temps presse : 3 à 4000 films commentés, un total comptant entre 5 et 6 millions de signes, ça ne se trouve pas sous les pieds d’un cheval, comme disait mon grand-père
Ecologie
On parle beaucoup du réchauffement climatique. C’est un enjeu considérable pour notre planète. Comment considérez-vous cela ? Comment a-t-on pu en arriver là ?
Comment ? Nous étions 80 millions à l’époque du Christ, nous sommes 6,5 milliards d’individus aujourd’hui sur notre petite boule. Nous serons 8 milliards en 2050, 9 ou 10 milliards à la fin du siècle. Au secours ! C’est trop, beaucoup trop ! Surtout si l’on prend en compte la soif d’énergie, donc de production de gaz à effet de serre qui nous dévore… On sait que si tous les humains adoptaient le mode de vie des Etats-Unis, il faudrait cinq Terres pour satisfaire aux besoins d’énergie de la planète. Est-ce que l’on n’y viendrait pas ? Pensons au développement sans frein de la Chine (dix pour cent de croissance annuelle), de l’Inde dont le but avoué est de dépasser la population chinoise à l’horizon du demi-siècle. Il y a de quoi être effrayé… Alors il faut faire quoi ? La solution Furet, la solution Monde enfin ? Pensons aussi qu’un milliard de personnes vit sans accès à l’eau potable, tandis que deux milliards vivent sans électricité. Faut-il laisser tout ceux-la dans leur misère ? C’est la quadrature du cercle.
Que faudrait-il faire pour améliorer les choses ?
La surpopulation est la clé de voûte du problème. Tout découle de là. Plus il y aura de gens et plus ils réclameront une vie décente (c’est bien le moins), plus on consommera. Donc il faudrait que s’amorce une courbe décroissante de la population afin que, en trois ou quatre génération, on redescende, puis on se stabilise à… quatre ou cinq milliards ? Ecrivant cela, je me rends bien compte que c’est utopiste. Qui prendrait cette décision ? (disons l’enfant unique sur la Terre entière). Comment l’appliquerait-on ? Qui l’accepterait ?
Les religions freinent des quatre fers. La population africaine, malgré la sécheresse, la famine, les guerres, le sida, doublera d’ici 2050. Et l’on ne se préoccupe nullement, nulle part, de la surpopulation. Bien au contraire ! En France, on se félicitait récemment de ce que le taux de fertilité était le meilleur d’Europe. C’est à se flinguer (ce qui en ferait déjà un de moins). Mais sans doute peut-on compter aussi sur la fin programmée des énergies fossiles. Quand il n’y aura plus de pétrole ni charbon, c’est sûr que le taux de concentration de CO2 dans l’atmosphère baissera.
Avez-vous prévu un tel scénario catastrophe ?
Moi, et bien d’autres écrivains de SF, parlons de pollution depuis trente ans et plus (cf. Brunner). Mais disons que le problème généraliste s’est resserré sur l’effet de serre depuis quinze ou vingt ans. Ce qui ne veut pas dire que le problème n’était pas prévisible depuis très longtemps : je viens de lire que le chimiste suédois Arrhenius avait prévu dès 1896 que la température de la Terre s’élèverait à cause de la combustion des ressources fossiles…
Nos hommes politiques sont-ils à la hauteur ?
Haha ! C’est une excellente question, comme on dit à la télé. On entend ahH Hhhhh
On entend sans doute de grandes déclarations d’intention, de bien belles paroles, comme celles de notre Président déclarant « la maison brûle et on regarde ailleurs »... et qui a aussitôt regardé ailleurs. Des mots, des mots ! disait Shakespeare. Et ne citons que pour mémoire Bush, qui ne croit toujours pas à l’effet de serre et s’arc-boute sur les positions de son père : « Le mode de vie américain n’est pas négociable ». La vérité est qu’un homme politique ne peut pas dire la vérité parce que, comme le clame Al Gore, c’est une vérité qui dérange. Et déranger, surtout en période électorale, impossible. On ne peut pas à la fois promettre la Croissance, l’Emploi, et dire qu’il va falloir se serrer la ceinture, moins consommer, moins dépenser, laisser sa voiture au garag e ? Quant à ceux qui devraient être le fer de lance du combat… vous avez entendu Oliver Besancenot ou l’Arlette évoquer l’effet de serre, vous ?
Faut-il envisager les adaptations aux changements climatiques déjà irréversibles ?
C’est sûr qu’il faudrait. Mais comment les mettre en vigueur de façon efficace ? Malgré la grande sympathie que je porte à Nicolas Hulot (lâcheur !), la réponse planétaire à l’effet de serre et aux autres effets de la politique de croissance, elle est politique, précisément. Elle exige un état fort et pourquoi pas une autorité supra-nationale (qui plairait sûrement à Wells), capable d’avoir la maîtrise de l’énergie, des transports, de l’aménagement du territoire, de l’agriculture, la pêche, etc. Les mesures à prendre doivent être anti-libérales et radicales - si le libéralisme économique, c’est faire n’importe quoi pour acquérir un profit illusoire et éphémère. Les grandes décisions - indispensables - sont encore à venir. Mais il est permis de ne pas désespérer, tout en étant bien conscient que ces mesures fâcheraient beaucoup de monde (les pêcheurs, pour ne citer qu’un cas dont on cause actuellement).

Avez-vous vu le film d’Al Gore « Une vérité qui dérange » et qu’en pensez-vous ? Faut-il multiplier les messages d’urgence pour toucher les consciences ?
Vu. C’est une œuvre utile, le genre de messages qui doivent se multiplier, et qui d’ailleurs se multiplient. Ceci dit, si la sincérité de Gore est indéniable, le critique de cinéma qui ne dort que d’un œil derrière l’écologiste regrette que ce film soit aussi ennuyeux, que ce brave Al ait autant de charisme qu’une aubergine et qu’on sente un peu trop, derrière les mots, la retape électoraliste.
Avez-vous lu le livre de Kim Stanley Robinson, « Les Quarante signes de la pluie » ?
Bien sûr… N’ai-je pas précisé qu’il faisait pour moi partie des nouveaux auteurs qui comptent ? On y trouve une relation raisonnée et raisonnable de ce qui nous attend - mais mieux vaut attendre de lire la trilogie au complet avant de se faire une opinion circonstanciée. Ce genre de romans va se multiplier, dès lors qu’il s’agit de traiter de l’avenir à court terme. Comment y échapper ? Ceci dit, pour le moment, je trouve bien plus frappant (et effrayant), La Mère des tempêtes, de John Barnes.
Que pensez-vous de l’attitude de Michael Crichton qui, avec son roman Etat d’urgence, va à contre-courant, en exprimant que le réchauffement de la planète est une théorie du complot élaboré à des fins politiques par des écologistes et des idéalistes ? Georges W. Bush a apprécié cette thématique de Crichton évidemment.
Celui-là, comme disait Cavanna, « Je l’ai pas lu… mais j’en ai entendu causer. » Alors je n’allais perdre mon temps à lire des conneries doublées d’une saloperie. Pourquoi pas du Thierry Meyssan, hein ?
Ceci dit, que cherche Crichton en publiant un texte pareil ? Il est déjà célèbre et milliardaire… Comprends pas.
N’est-ce pas terriblement contre-productif qu’un auteur comme Crichton s’engage ainsi sous prétexte que le débat sur le climat est politisé ?
Comme quoi tout acte de création est engagé puisque l’avenir de l’humanité est engagé. Les artistes ne devraient-ils pas aller plus loin dans leur engagement étant donné l’urgence ?
Ni plus ni moins que n’importe quel citoyen - ce que nous sommes : des citoyens comme n’importe qui. Naturellement, le tambour de résonance croît avec l’accès aux médias, qui croît avec la célébrité. Voir Suzan Saradon et Sean Penn manifester contre la guerre en Irak, ça fait toujours plaisir. S’ils en entraînent d’autres, c’est tout bénéfice pour la cause de la survie, et mieux que d’aller se réfugier en Suisse.
Ces temps-ci, en France, une campagne d’information nous invite à changé nos petits gestes quotidiens. Mais si, à une échelle supérieure, celle des états, on ne change rien, n’est-ce pas un alibi pour accuser les populations plus tard de n’avoir pas fait assez et dédouaner ainsi les politiques qui ne font pas grand-chose ?
C’est probable, et en même temps il faut se garder de tomber dans la paranoïa. Même les petits gestes (éteindre la lumière en sortant d’une pièce, fermer l’eau quand on se brosse les dents, préférer le train à la voiture ou l’avion, ne pas vouloir manger des fraises en hiver…), tout s’additionne, donc tout compte. Encore faut-il ne pas entretenir de fausses illusions, comme autant de faux espoirs. L’énergie éolienne, c’est bien. Mais elle ne pourrait couvrir qu’entre 10 et 20% des besoins énergétiques actuelles de la France… en multipliant par quarante le nombre d’aérogénérateurs en service, qui ne représentent pour l’instant que 0,5% de la consommation. Pareil pour les biocarburants puisque, si l’on voulait fournir de quoi alimenter le parc automobile (comme on dit) français, il serait nécessaire de transformer toutes les surfaces cultivables en champs de colza ou de soja. Alors quoi ? Alors je suis écrivain, moi, m’sieur. Rien d’autre.
Last but not least une question classique : vos projets ?
A part le dico et l’expo sur les paysages d’après la catastrophe, je me suis mis d’accord avec mes deux principaux éditeurs chéris (Bénédicte Lombardo pour le Fleuve Noir et Olivier Girard pour le Bélial’) pour leur fournir un roman nouveau à chacun, dont le synopsis est bien sûr déjà cuisiné aux petits oignons. Mais quand ? Je préfère laisser sous silence cette question épineuse. 2008 verra par ailleurs la réédition de deux ouvrages dont il a été question plus haut : Le Monde enfin chez Pocket et Sukran en Folio SF. Avec Afif, on cuisine à feu doux un nouvel album (cette fois un One shot, sur un scénario original). J’ai aussi des projets cinéma et télé, mais je préfère ne pas en dire plus pour l’instant. Enfin, je vais sans doute enfin enregistrer un CD de mes meilleures chansons.
Allez, un petit whisky, maintenant. Et merci de votre attention.






