Robert le Diable (Meyerbeer)

Le Grand Opéra Français est un art total et complexe : sa réussite demande un équilibre parfait entre ses multiples composantes, tant scéniques que chorégraphiques, orchestrales et vocales. Genre très exigeant, mais qui semble petit à petit retrouver le succès grâce à une approche historique nouvelle, à la prestation de voix capables d’affronter des tessitures éprouvantes et de tenir cinq longs actes, ce qui requiert une endurance particulière.
A l’instar de ce qui s’est passé dans la seconde moitié du siècle dernier pour le bel canto italien, il semblerait que l’heure soit cette fois venue pour une autre forme redoutable. Il suffit de se rappeler les reprises à l’Opéra de Paris de ce Robert le Diable, et de La Juive d’Halévy, du Prophète à Vienne ou des Huguenots à Liège et, surtout, à La Monnaie de Bruxelles en 2011, exemple de réussite parfaite.
Là, le Grand Opéra est apparu dans toute sa force dramatique et sa splendeur vocale : il a révélé toutes ses éclatantes qualités, grâce aux talents conjugués d’Olivier Py, de Marc Minkowski et d’une pléiade de solistes nouvellement rompus à ce répertoire.
Il est donc évident que l’on attendait, avec curiosité et impatience, ce nouveau Robert le Diable, immense succès créé à Paris en 1831, et que Covent Garden n’avait plus représenté depuis 1890. Et il faut avouer que l’attente n’a été que partiellement comblée. Certes, la soirée fut une grande réussite musicale mais on n’a pas atteint l’équilibre si nécessaire à cet ensemble fragile qu’est un Grand Opéra. En cause : la mise en scène pour le moins inégale de Laurent Pelly, que l’on a connu autrement plus inspiré (pensons à ces deux récents Massenet à La Monnaie, Don Quichotte et Cendrillon).
Rappelons brièvement la trame. Le duc Robert de Normandie, qui ignore être le fils du diable Bertram, est amoureux de la princesse Isabelle de Sicile. Pour la conquérir, il s’allie les forces démoniaques en cueillant un rameau magique gardé par des nonnes damnées que le diable a ramenées à la vie. Robert, soutenu par sa sœur de lait Alice, fiancée du troubadour Raimbaut, connaît maintenant son père et sera sauvé in extremis des flammes de l’Enfer.
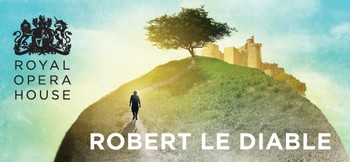
Dans les opéras de Meyerbeer, chaque acte forme un tout complet, un univers en soi, soigneusement composé et articulé, à l’atmosphère particulière. Pelly conçoit l’œuvre en deux grandes parties, le troisième acte et les quatre autres. L’acte III est très réussi, il faut l’avouer. Un grand rocher à trois facettes symbolisait le « paysage sombre et montagneux » de la didascalie : un chemin désolé, les bouches rouges de l’Enfer (avec cadavres de damnés tombant dans la géhenne comme dans un tableau de Jérôme Bosch) et un vallon dominé par un gigantesque crucifix. Quant à la fameuse scène de la résurrection des nonnes, clou spectaculaire de l’acte et de l’opéra tout entier, elle ne se déroulait pas dans un cloître comme lors de la création (le célèbre décor de Ciceri), mais dans les ruines d’une chapelle abandonnée. Hésitantes et encore rigides, les mortes vivantes sortent lentement de leur tombeau pour s’animer petit à petit et enfin séduire le pauvre Robert qu’elles contraignent à s’emparer du rameau magique fleurissant sur le lit de sainte Rosalie. A cet instant fatal surgit la foule macabre des damnés hurlant sa joie sacrilège dans une orgie furieuse : spectacle terrible, épouvantable, très « romantique » de 1831.
Mais pour ce moment remarquable, il a fallu endurer une approche radicalement différente des quatre actes extrêmes. Ceux-ci relevaient en effet bien plus de l’opéra-comique que de la terreur fantastique propre au sujet. Chevaux de bois multicolores et chœur saccadé de chevaliers à l’acte I, mini château de carton-pâte pour le palais de la princesse Isabelle et tournoi ridicule de cavaliers tombant des cintres sur leurs destriers à l’acte II, décor repris à l’acte IV. Le comble était atteint à l’acte V où, devant un squelette d’église en papier, Robert hésite entre le Bien et le Mal, représentés par une Alice en costume de madone priant sur un matelas de nuages, et un Bertram gesticulant devant un masque de démon rougeoyant : un vrai sommet du kitsch qui détruisait toute l’illusion du combat désespéré mené par le héros à ce moment ultime.
On sait que Robert le Diable était à l’origine destiné à l’Opéra-comique, certes, mais les auteurs ont entièrement refondu leur œuvre pour la scène de l’Opéra. Cette discrépance entre une intrigue tragique et un décor mignon et gentillet (qui parfois a même fait rire le public) était tout à fait hors de propos. Que l’on était loin de la mise en scène fantasmagorique et un peu grandiloquente mais… diablement efficace de Petrika Ionesco à Garnier en 1985 !
Heureusement, la musique a sauvé ce spectacle bancal. En effet la distribution réunie s’est avérée fabuleuse, à commencer par le héros éponyme du brillant ténor américain Bryan Hymel, qui a témoigné d’une énergie à toute épreuve (et d’aigus superbes) tout au long des cinq actes. Le Bertram du Canadien John Relyea, aux graves impressionnants, moins spectaculaire sans doute que Samuel Ramey à Paris, n’en était pas moins tout à fait en situation. L’Alice de Marina Poplavskaia a frappé par une puissance dramatique étonnante qui a éloigné de toute mièvrerie ce rôle qui évoque un peu celui de Micaëla dans la Carmen de Bizet. Il va sans dire que le fameux trio a capella de l’acte III « Fatal moment, cruel mystère » a figuré parmi les tous grands instants de la soirée. Patrizia Ciofi remplaçait Jennifer Rowley, à la demande même de la direction du Royal Opera House, qui a estimé sa voix trop dramatique. La princesse Isabelle de Ciofi (qui interprète le rôle dans la seule version CD officielle en français disponible) a ravi le public par sa présence aussi noble qu’aimable et par d’impeccables vocalises. Ses deux airs, en particulier « Robert, toi que j’aime », à l’acte IV, sublime, ont récolté une ovation bien méritée. Le Raimbaut de Jean-François Borras, seul soliste français, a séduit par son aisance sur scène et une articulation toute naturelle.

Chœurs excellents et orchestre subtil, dirigé par le chef israélien Daniel Oren, qui a bien souligné les nombreuses trouvailles instrumentales de l’orchestre meyerbeerien, lesquelles avaient si fort intéressé Berlioz : emploi caractéristique des bois dans le ballet des nonnes par exemple, singulier motif à la timbale solo, cuivres caverneux, interventions de l’orgue.
Un spectacle bancal donc, ai-je écrit, et dont l’incontestable réussite musicale n’a pas réussi à masquer l’échec scénique. On peut instiller de la dérision ou du second degré dans Don Giovanni, Carmen, La Traviata ou même le Ring der Niebelungen, « tubes » de l’opéra suffisamment représentés dans le monde : le « Regietheater » s’en charge et ils s’en sortiront toujours. Mais le Grand Opéra a ses règles : il faut les respecter.
Il est à espérer qu’il ne s’agit que d’une erreur de parcours pour Laurent Pelly et, surtout, qu’elle n’entravera pas la nouvelle et délicate carrière sur les scènes actuelles du premier grand opéra de Meyerbeer, dont le public a bien pu apprécier les incontestables beautés musicales.
Royal Opera House, 15 décembre 2012.
(écrit pour la revue Crescendo)






