Fenêtre sur l'oeuvre de Julien Gracq
Cher Marc,
Quelques pages de Gracq suffiront à combler cette nuit et à clore nos promenades. Je ne vais pas mentir : une nuit ne suffit pas à lire dix pages de Gracq. Voilà bien un mois que je me suis replongée dans Au château d’Argol et Le rivage des Syrtes, dans le plus grand désordre et avec le même plaisir que lorsque je les savourais pour la première fois, page à page, dans les luxueuses éditions de José Corti, coupe papier en main.

Lire ou relire Gracq, c’est une expérience unique, intime, liée à ce type d’édition qui, volontairement, refuse à la littérature son statut "populaire". C’est se plonger dans un monde de références littéraires et philosophiques, en même temps que dans l’univers de ses propres souvenirs de lectures, pour soudain s’émerveiller de la fraîcheur, de la justesse d’une émotion, au détour d’une phrase ; le désir : "...surgissant derrière elle, et tout battant d’un sang brutal à l’aveu de cette faiblesse qui me transperçait délicieusement...", la tendresse : "alors l’excès de ma tendresse pour elle se réveillait : mes baisers emportés pleuvaient de toutes parts sur ce corps défait comme une grêle", l’amour, - qui ne peut jamais être que fatal - : "Elle me paraissait soudain extraordinairement belle, - d’une beauté de perdition -, pareille, sous sa chevelure lourde et dans sa dureté chaste et cuirassée, à ces anges cruels et funèbres qui secouent leur épée de feu sur une ville foudroyée" ; le désespoir : "(...) elle était cette nuit où je n’entrais pas, un ensevelissement vivace, une ténèbre ardente et plus lointaine, et toute étoilée de sa chevelure, une grande rose noire dénouée et offerte, et pourtant durement serrée sur son coeur lourd".
La géographie des lieux est symbolique et peut paraître, à première vue, banale : on trouvera par exemple toujours chez Gracq un château, sombre, austère, aux pièces immenses ou resserrées, aux murs nus ou couverts de portraits inquiétants, aux passages secrets dégoulinants de toiles d’araignée, peuplé d’ombres, de fantômes et de personnages qui y promènent leur angoisse, dans l’attente du dénouement de leur destinée. Château ou manoir, château-manoir où se mélangent les époques et les styles dans des descriptions enchanteresses et complexes, qui rappelle tout ensemble l’univers de Sade, Poe, Stoker, Shelley, des contes aussi (la Belle au bois dormant, la Belle et la Bête), dans un gothique à la fois échevelé et minutieux, dont la magie opère à coup sûr, car elle englobe toutes les représentations sans en privilégier aucune.
Le château d’Argol est par conséquent d’une complexité surprenante ; il étonne par ses contradictions architecturales, et pourtant, sa vue procure aussitôt au personnage d’Albert "un singulier sentiment de réconfort et - dans l’acceptation la plus minutieuse de ce mot - de reconnaissance". Le sentier qui y mène est tortueux, "impraticable à toute voiture", et on y parvient au terme d’une ascension éprouvante :
"A l’instant où Albert atteignit le sommet de ces pentes raides, la masse entière du château sortit des derniers buissons qui la cachaient.
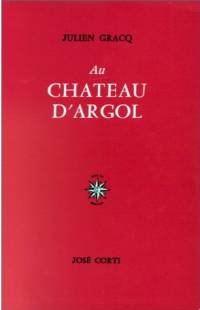 Il fut alors visible que la façade barrait tout à fait l’étroite langue du plateau. Appuyée à gauche à la haute tour ronde, elle était uniquement constituée d’une épaisse muraille de grès bleus maçonnés à plat et enrobés dans un ciment grisâtre. Le caractère le plus imposant de l’édifice venait du toit, façonné en terrasse, particularité très rare sous un climat toujours pluvieux : le sommet de cette haute façade appliquait contre le ciel une ligne horizontale et dure, comme les murs d’un palais détruit par l’incendie, et parce que, comme la tour, on ne pouvait le considérer que du pied seulement de la muraille, produisait une impression indéfinissable d’altitude. La forme et la disposition des rares ouvertures n’étaient pas moins frappantes. Toute notion d’étage, liée presque indissolublement à notre époque à celle d’une construction harmonieuse, semblait en avoir été bannie. De rares fenêtres s’ouvraient dans la muraille à des hauteurs presque toujours inégales, suggérant l’idée d’une distribution intérieure étonnante. Les fenêtres basses offraient toutes la forme de rectangles bas et très allongés, et il était alors visible que l’architecte s’était inspiré du dessin de certaines meurtrières pratiquées dans les châteaux-forts anciens pour le tir des couleuvrines. Aucune pierre de couleur n’agrémentait les bords de ces longues et étroites fissures qui s’ouvraient dans le mur nu comme un soupirail inquiétant. Les fenêtres hautes étaient constituées par des arcs d’ogive d’une élévation et d’une étroitesse surprenantes, et la direction de ces lignes verticales, élancées et presque convulsives, formait avec la crête lourde et horizontale des parapets de granit de la haute terrasse un contraste accablant. Toutes les fenêtres étaient garnies de vitraux aux formes anguleuses et irrégulières, sertis dans des lames de plomb. La porte, basse et étroite, faite de plaques de chêne sculpté où brillaient des clous de cuivre, s’ouvrait à gauche de la façade, au pied de la tour de guet".
Il fut alors visible que la façade barrait tout à fait l’étroite langue du plateau. Appuyée à gauche à la haute tour ronde, elle était uniquement constituée d’une épaisse muraille de grès bleus maçonnés à plat et enrobés dans un ciment grisâtre. Le caractère le plus imposant de l’édifice venait du toit, façonné en terrasse, particularité très rare sous un climat toujours pluvieux : le sommet de cette haute façade appliquait contre le ciel une ligne horizontale et dure, comme les murs d’un palais détruit par l’incendie, et parce que, comme la tour, on ne pouvait le considérer que du pied seulement de la muraille, produisait une impression indéfinissable d’altitude. La forme et la disposition des rares ouvertures n’étaient pas moins frappantes. Toute notion d’étage, liée presque indissolublement à notre époque à celle d’une construction harmonieuse, semblait en avoir été bannie. De rares fenêtres s’ouvraient dans la muraille à des hauteurs presque toujours inégales, suggérant l’idée d’une distribution intérieure étonnante. Les fenêtres basses offraient toutes la forme de rectangles bas et très allongés, et il était alors visible que l’architecte s’était inspiré du dessin de certaines meurtrières pratiquées dans les châteaux-forts anciens pour le tir des couleuvrines. Aucune pierre de couleur n’agrémentait les bords de ces longues et étroites fissures qui s’ouvraient dans le mur nu comme un soupirail inquiétant. Les fenêtres hautes étaient constituées par des arcs d’ogive d’une élévation et d’une étroitesse surprenantes, et la direction de ces lignes verticales, élancées et presque convulsives, formait avec la crête lourde et horizontale des parapets de granit de la haute terrasse un contraste accablant. Toutes les fenêtres étaient garnies de vitraux aux formes anguleuses et irrégulières, sertis dans des lames de plomb. La porte, basse et étroite, faite de plaques de chêne sculpté où brillaient des clous de cuivre, s’ouvrait à gauche de la façade, au pied de la tour de guet".
A la difficulté du sentier, à ce paysage sombre, s’oppose simultanément une aile du château brillante, spacieuse, gaie, "de nobles fenêtres semblant éclairer de riants appartements". La magie se transforme, le paysage nous projette brusquement dans un univers plus féerique que fantastique, avec la vision d’une pelouse "d’un vert brillant" :
"Aucun sentier n’y paraissait tracé : la porte du château s’ouvrait directement sur les moelleux tapis de la pelouse, et cette particularité bizarre, mise en relation avec le dessin archaïque et difficile du sentier du château, ne laissa pas de surprendre fortement Albert".
De même les appartements de Vanessa dans Le rivage des Syrtes surprennent Aldo, et l’immensité du décor devient pour lui oppressante :
"Je me levais, je marchais nu dans les enfilades de pièces aussi abandonnées qu’au coeur d’une forêt, presque gémissantes de solitude, comme si quelque chose d’alourdi et de faiblement voletant m’eût fait signe à la fois et fui de porte en porte à travers l’air stagnant de ces hautes galeries moisies (...)".
Châteaux mystérieux donc, enfoncés dans des forêts obscures, cimetières où la mort et l’amour se retrouvent, chapelles d’où s’échappent une musique envoûtante, golfes et océans où les femmes ensevelissent leurs cheveux et paraissent marcher sur les eaux, à moins qu’il ne s’agisse d’une eau morte propice à l’apparition de navires fantômes, dans une ambiance chargée d’anxiété :
"Au travers de l’atmosphère saturée de ce pays des eaux, le fourmillement des étoiles par la fenêtre ne scintillait plus ; il semblait que de la terre prostrée ne pût désormais se soulever même le faible souffle qui s’échappe d’un poumon crevé : la nuit pesait de tout son poids sur elle dans son gîte creusé de bête lourde et chaude. Quelquefois, derrière la barre de la lagune, un aviron par intervalles tâtait l’eau gluante, ou tout près s’étranglait le cri falot et obscène d’un rat ou de quelque bête menue comme il en rôde aux abords des charniers".
L’imaginaire de Gracq, profondément empreint d’idéalisme allemand, nous ramène inévitablement à Kant. Il se veut détaché d’une esthétique "grossière", évoluant librement, hors des sentiers connus, et le lecteur conquis adhère à cette écriture à la fois ciselée et débridée, se laissant porter au gré d’un mystère qui ne fait que s’épaissir au fur et à mesure qu’il se révèle. Au château d’Argol fait clairement référence à Kant de ce point de vue, dévoilant, à travers le personnage féminin de Heide, l’intention de l’auteur, et son idéal esthétique :
"Comme portés par le réseau d’une musique exaltante, ses membres paraissaient prisonniers des lois fatales d’un nombre -quoi qu’il en fût à tous égards premier- et sa démarche majestueuse au-delà de toute mesure, et à tout moment visiblement orientée, sembla à Albert la matérialisation, pour la première fois débarrassée de toute espèce de voiles grotesquement esthétiques, de ce que Kant a appelé non sans mystère une finalité sans représentation de fin".
Ce refus déclaré d’un récit, d’une architecture pensés d’avance, crée le rythme hypnotique de ces romans où l’on s’enfonce comme dans un rêve, délicieusement sûrs de ne jamais rien contrôler, de ne jamais rien savoir de façon certaine, et où la crainte des cataclysmes pressentis et inévitables se joint à la sensualité de l’instant vécu. A l’influence de l’idéalisme allemand se mêle ainsi naturellement celle du surréalisme, dont Gracq se réclame aussi. Ecriture hypnotique, qui renie les schémas classiques, temps suspendu, paysages intérieurs qui rappellent les tableaux de Dali et Magritte :
"... et peut-être ne lui fut-il pas perceptible, au milieu de son tumultueux émoi,combien plus haut que toutes les voix de la nature résonnait ici avec un fracas dissonant l’éclatante désappropriation de toutes choses, de l’autel plus majestueux d’être déserté, de la lance inutile, du tombeau inquiétant comme un cénotaphe, de l’horloge tournant à vide au-delà du temps sur lequel ne mordaient pas plus ses engrenages que la roue d’un moulin sur un ruisseau desséché, de la lampe brûlant en plein jour et des fenêtres visiblement faites pour regarder de dehors en dedans, et auxquelles se collaient partout à la fois les verts tentacules de la forêt".
Si la géographie de Gracq fait ainsi rêver, que dire de sa vision de l’Histoire dans Le rivage des Syrtes ? La ville d’Orsenna, Maremma, les Syrtes : la guerre imminente, incompréhensible, le suicide collectif des civilisations : on pourrait presque parler d’un roman d’anticipation ! Comme il sait nous faire rêver des lieux, Gracq nous fait rêver de l’Histoire, une Histoire inéluctable, jalonnée de quantité de petites histoires, d’amours, d’orgueils, de trahisons, du sentiment général d’impuissance et de résignation face au destin ; une Histoire dont le mystère est tout entier contenu dans la confession finale de son gardien, Danielo :
..." Ne regrette rien, dit-il en me serrant la main de nouveau avec une émotion brusque, je ne regrette rien moi-même. Il ne s’agit pas d’être jugé. Il ne s’agissait pas de bonne ou de mauvaise politique. Il s’agissait de répondre à une question - à une question intimidante - à une question que personne encore au monde n’a pu jamais laisser sans réponse, jusqu’à son dernier souffle.- Laquelle ? - "Qui vive ?" dit le vieillard en plongeant soudain dans les miens ses yeux fixes".
Avant que la nuit ne s’achève, c’est avec Gracq que je voudrais la traverser, ou avec Aldo, le héros du Rivage des Syrtes, dans l’exaltation que dégage pour lui, comme pour nous tous, cette certitude :
"Je marchais le coeur battant, la gorge sèche, et si parfait était autour de moi le silence de pierre, si compact le gel insipide et sonore de cette nuit bleue, si intrigants mes pas qui semblaient poser imperceptiblement au-dessus du sol de la rue, je croyais marcher au milieu de l’agencement bizarre et des flaques de lumière égarantes d’un théâtre vide - mais un écho dur éclairait longuement mon chemin et rebondissait contre les façades, un pas à la fin comblait l’attente de cette nuit vide, et je savais pour quoi désormais le décor était planté".






