Cerbères and Cie
Cher Marc,
Il faut reconnaître que le fantastique fait partie intégrante de notre vie, et pas toujours pour notre bien. En général, il y cohabite volontiers avec l’absurde : là, nul besoin de spectres, oiseaux lugubres, vampires, goules, et autres abominations lovecraftiennes ! Ces pauvres choses ne sont que des fantasmes, des cauchemars que la lueur du jour a tôt fait de dissiper. Je préfèrerais avoir affaire à une armée de fantômes, à une populace affamée de morts-vivants, plutôt qu’à ce fantastique quotidien, tangible, gluant, qui s’inscrit dans toute la durée de la vraie vie, depuis le matin au réveil jusqu’au retour à la maison le soir, jour après jour : j’ai nommé le fantastique administratif !
D’accord, il y a toujours des aspects qui font sourire. Imagine donc : Electricité Gaz de France reçoit l’avis de décès d’un client, et lui renvoie par retour du courrier un commandement de payer, sinon... (sinon quoi ? La pauvre âme au Purgatoire là-haut, ils lui coupent le jus ?...)
J’ai ainsi moi-même reçu aujourd’hui un avertissement d’une de ces entités, au sujet d’un supposé employé, évidemment inexistant ; j’ai tenté d’appeler le numéro indiqué en haut de la page. Un répondeur m’a révélé que ce numéro était, lui aussi, "inexistant". Que faire ? Je pourrais téléphoner aux Télécom, mais je crains que cela ne complique encore les choses avec des fantômes qui ne seraient pas de la même famille, et dont les accointances ou les antipathies mystérieuses entre eux m’échappent.
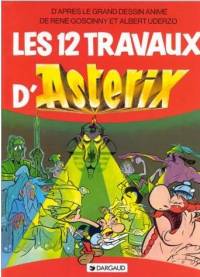 Je m’incline donc devant cette autorité quasi surnaturelle, qui a inspiré les plus grands auteurs (y compris Gosciny dans Les douze travaux d’Astérix, qui intercale entre les pyramides piégées et l’énigme du sphinx l’épisode de la quête impossible du formulaire B143 !), et devant la pérennité de ce phénomène étrange et inquiétant, je joins à mes poètes de ce soir le grand, l’incontournable classique qu’est Kafka !
Je m’incline donc devant cette autorité quasi surnaturelle, qui a inspiré les plus grands auteurs (y compris Gosciny dans Les douze travaux d’Astérix, qui intercale entre les pyramides piégées et l’énigme du sphinx l’épisode de la quête impossible du formulaire B143 !), et devant la pérennité de ce phénomène étrange et inquiétant, je joins à mes poètes de ce soir le grand, l’incontournable classique qu’est Kafka !
Plongeons donc dans l’Insoutenable Eternité de l’Angoisse ! "Vous qui entrez, quittez toute Espérance..."
Ce type de fantastique marque notre imaginaire à la façon d’un véritable traumatisme : châteaux ou bâtiments maudits, prisons aux labyrinthes mortels, cryptes antiques ou tours, gratte ciels modernes gigantesques, où l’individu écrasé se perd, toujours gardés par des cerbères implacables et monstrueux, qui n’ont rien d’humain, ou ont une fausse apparence humaine...
Il faut la géniale insolence et la jeunesse de Rimbaud pour parvenir à tourner la Bête immonde, le gardien du temple, en ridicule. Ah ! ce poème sur "Les Assis", si justement célèbre (tout aussi célèbre, sinon plus, que le Bateau ivre), quelle délectation pour tous ceux qui ont souffert, et souffrent régulièrement l’expérience de la bureaucratie triomphante ! Enfin, quelqu’un qui nous venge un peu ! "Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges,/Sentant les soleils vifs percaliser leur peau,/ Ou, les yeux à la vitre où se fanent les neiges, /Tremblant du tremblement douloureux du crapaud." (...) "Ils ont greffé dans des amours épileptiques /Leur fantasque ossature aux grands squelettes noirs/De leurs chaises... (...) "La description est-elle assez cruelle, assez méchante pour soulager notre dépression latente ! Et enfin le rire salutaire à la vision de ces "assis" qui, "Quand l’austère sommeil a baissé leurs visières,/(...) rêvent sur leurs bras de sièges fécondés,/De vrais petits amours de sièges en lisières/ Par lesquelles de fiers bureaux seront bordés." Voilà un autre fantastique, que je qualifierais volontiers de "compensatoire" : des chaises rêvant de fécondation ! Face à l’oppresseur, l’imagination réagit de façon saine et bienvenue.
Ne nous y trompons pas cependant : le sentiment premier reste la peur : "Oh ! Ne les faites pas lever... C’est le naufrage !/ Ils surgissent, grondant comme des chats giflés, (...)/Puis ils ont une main invisible qui tue :/Au retour, leur regard filtre ce venin noir/ Qui charge l’oeil souffrant de la chienne battue,/Et vous suez, pris dans un atroce entonnoir"... Réaction semblable devant les douaniers belges, qui arrêtent Rimbaud et Delahaye à la frontière ; la crainte de ces "Soldats des Traités" a probablement été éprouvée. Crainte de l’arrestation, malaise de se sentir coupable, terreur devant le monstre détenteur d’un pouvoir vécu à la fois comme incompréhensible et injuste : "Quand l’ombre bave aux bois comme un mufle de vache,/ Ils s’en vont, amenant leurs dogues à l’attache, /Exercer nuitamment leurs terribles gaietés./Ils signalent aux lois modernes les faunesses./ Ils empoignent les Fausts et les Diavolos./ "Pas de ça, les anciens ! Déposez les ballots !" Remarquons que la victime l’est ici d’autant plus que ce monde lui est étranger : elle appartient au passé, le cerbère à la modernité, les deux fantastiques ne peuvent que se heurter. Faust est sans défense face au douanier, comme l’est le poète romantique face à la société moderne déshumanisante.
 Le cerbère, quelle que soit sa fonction, bibliothécaire, douanier, portier, chef de bureau ou autre, susceptible d’engendrer une peur panique , et, parfois, une ironie ou un humour bon enfant, ne représente pourtant que la partie visible de l’iceberg. Derrière lui se profile un océan d’ angoisses autrement terrifiant. Cet univers se dévoile soudain, ou progressivement, à travers la certitude qu’ il existe au dessus de nous une puissance quasi divine, mystérieuse et innommée, ou désigné par une terminologie vague et énigmatique, "la Compagnie", "le Château", "l’Etat", qui a tout moment risque de surgir pour, au pire, nous écraser, au mieux, empoisonner notre vie. Et cette entité inflige à l’individu une torture diabolique, le dépouillant systématiquement de ses aspirations naturelles et légitimes à la liberté, à l’égalité, à la fraternité, à l’amour, à l’amitié, au bonheur : elle le réduit à l’état de robot, ou le voue à l’anéantissement pur et simple : son outil favori ? la consigne ; la procédure. Bref, en gros : le système.
Le cerbère, quelle que soit sa fonction, bibliothécaire, douanier, portier, chef de bureau ou autre, susceptible d’engendrer une peur panique , et, parfois, une ironie ou un humour bon enfant, ne représente pourtant que la partie visible de l’iceberg. Derrière lui se profile un océan d’ angoisses autrement terrifiant. Cet univers se dévoile soudain, ou progressivement, à travers la certitude qu’ il existe au dessus de nous une puissance quasi divine, mystérieuse et innommée, ou désigné par une terminologie vague et énigmatique, "la Compagnie", "le Château", "l’Etat", qui a tout moment risque de surgir pour, au pire, nous écraser, au mieux, empoisonner notre vie. Et cette entité inflige à l’individu une torture diabolique, le dépouillant systématiquement de ses aspirations naturelles et légitimes à la liberté, à l’égalité, à la fraternité, à l’amour, à l’amitié, au bonheur : elle le réduit à l’état de robot, ou le voue à l’anéantissement pur et simple : son outil favori ? la consigne ; la procédure. Bref, en gros : le système.
Il y a sur ce point dans l’oeuvre de Kafka des moments particulièrement poignants. Voici que le jeune K., sans le vouloir, heurte les sentiments du portier qui l’a embauché comme groom. Il n’a pas salué correctement, il n’a pas suivi très exactement le protocole. Le portier, le cerbère de l’endroit ("un homme de haute taille", que "son costume rendait plus large d’épaules que la nature ne l’avait fait", et dont la moustache noire "restait raide, si vite qu’il tournât le chef"), qui lui voue depuis le début une haine infinie, en profite pour le renvoyer. Ce qui est tragique dans cette scène, ce ne sont pas tellement les faits en eux-mêmes mais la façon dont ils apparaissent vécus de l’intérieur par le personnage. Un mécanisme humain tend pourtant aussitôt à se mettre en place autour de lui, pour préserver ses intérêts : il se trouve que le gérant est amoureux de la cuisinière en chef, qui le protègera, car elle est l’amie de son amie Thérèse qui veut le protéger, elle aussi. Mais face au système administratif enclenché par la haine du cerbère, ce pauvre mécanisme humain d’entraide, il le sait d’avance, sera impuissant ; il ne peut même que précipiter l’issue fatale, en accentuant la violence de la scène. Ainsi K supplie-t-il son amie de l’abandonner à son sort, sans pouvoir s’empêcher en même temps de lui exprimer son sentiment d’injustice, et tout en sachant qu’il ferait mieux de le lui taire ! "Je t’en prie, Thérèse, va-t-en maintenant. Je ne me défendrai pas si bien si tu restes là, et j’en ai besoin parce qu’on me reproche des choses fausses. Plus je ferai attention, mieux je saurai me défendre, et plus j’aurai d’espoir de rester... Allons, Thérèse... " "Malheureusement, la douleur l’ayant lanciné subitement, il ne put s’empêcher d’ajouter à voix basse : "Si seulement ce portier me laissait ! J’ignorais complètement qu’il me voulait du mal ! Mais il me serre il me tire tout le temps !" "Pourquoi vais-je donc dire ça ! pensait-il en même temps, il n’y a pas de femme qui puisse écouter cela de sang froid ! ". "Et effectivement, (...) Thérèse s’était retournée vers lui : "Monsieur le portier en chef, lâchez tout de suite Rossmann, s’il vous plaît. Vous lui faites du mal. Mme la cuisinière en chef va venir et on verra bien qu’on s’est trompé sur tout.". (...) "C’est la consigne, ma petite demoiselle, c’est la consigne", dit le portier (...)".
Autre scène hallucinante de vérité, toujours dans "l’Amérique", l’errance du jeune K dans les divers bureaux d’embauche du "Grand Théâtre d’0klahoma" : il affronte d’abord le "secrétariat pour ingénieurs", mais il lui manque des papiers d’identité ; il est renvoyé au "secrétariat pour gens possédant des connaissances scientifiques", mais là ce sont ses diplômes qui posent problème : "lorsque Karl eut expliqué, dans cette nouvelle section, que l’école supérieure qu’il avait fréquentée était un établissement européen, on se déclara une fois de plus incompétent et on le fit conduire au secrétariat pour anciens élèves d’écoles supérieures européennes. C’était un box situé tout au bout du terrain, et non seulement plus petit, mais encore plus bas que les autres. (...) Ce secrétariat représentait le suprême recours". Mais au moment où il est enfin accepté, voilà que K. hésite à donner son nom : le premier effet de cet univers bureaucratique est en effet d’ébranler la notion d’identité. Que risque-t-il de lui arriver s’il ose donner son véritable nom, et que celui-ci se trouve inscrit sur le registre ? D’ailleurs, a-t-il encore un nom ? lequel ? Dans le doute, il confond son nom véritable avec celui qu’on lui attribuait dans sa profession de groom : "Negro" : "Le secrétaire observa le jeune homme un instant d’un air scrutateur, mais il finit par répéter le nom de Negro et par l’enregistrer"
Même chose dans "Le Château", qui n’est autre que le récit de l’interminable parcours de K. dans les dédales administratifs : là aussi, protocole, procédure, lenteur. Remarquons que Kafka ne manque pas d’humour dans ses cauchemars les plus vivaces ! "Au Château, tout va toujours très lentement et l’ennui est qu’on ne sait jamais ce que signifie cette lenteur ; elle peut signifier que l’affaire suit la voie administrative, mais elle peut aussi signifier que rien n’est encore amorcé, (..) et peut-être même que l’affaire a déjà été réglée (...)
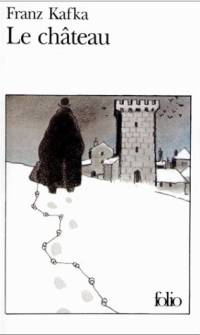 On ne peut rien savoir de plus précis, tout au moins de très longtemps. On cite au village un proverbe que tu connais peut-être déjà : "les décisions de l’administration sont timides comme des jouvencelles". "Voilà qui est fort bien observé, dit K. (...) les décisions de l’administration doivent avoir encore bien d’autres traits communs avec les jouvencelles". "Peut-être, dit Olga ; je ne vois pas très bien ce que tu veux dire. Peut-être l’entends-tu comme un éloge ?".
On ne peut rien savoir de plus précis, tout au moins de très longtemps. On cite au village un proverbe que tu connais peut-être déjà : "les décisions de l’administration sont timides comme des jouvencelles". "Voilà qui est fort bien observé, dit K. (...) les décisions de l’administration doivent avoir encore bien d’autres traits communs avec les jouvencelles". "Peut-être, dit Olga ; je ne vois pas très bien ce que tu veux dire. Peut-être l’entends-tu comme un éloge ?".
"Le Procès", évidemment, reste du point de vue de ce fantastique-absurde le grand chef-d’oeuvre de Kafka : nous assistons dans les plus infimes détails à toute la procédure du jugement du personnage et à sa condamnation, son anéantissement physique : sans que ni lui ni personne ne sache ce qui lui est jamais reproché au juste (il est de toute évidence innocent). C’est la culmination dans l’horreur. Mieux vaut encore, allez, la simple punition du renvoi ! On a l’impression de s’en tirer à bon compte...
Aucune intimité, bien sûr, dans ce contexte : "on est observé constamment, on se le figure tout au moins". A chaque bureau son cerbère, dont le rôle est d’espionner, observer, dénoncer, et sa victime, vouée à une paranoïa latente...
Et l’amour alors, qu’en est-il ? Heu... Ce n’est guère plus brillant que chez Lovecraft. Il n’y a que des pulsions sexuelles subies, dont le jeune K. est la plupart du temps la victime. Harcèlement moral, harcèlement sexuel, voici des termes techniques très courants dans la vie de nos sociétés d’aujourd’hui, qui prennent toute leur dimension psychologique et leur ampleur fantastique à la relecture des oeuvres de Kafka.
La géographie, l’architecture participent à cette horreur quotidienne. Celles du travail tout d’abord : "Les bureaux sont-ils le vrai Château ? Et même si certains bureaux font bien partie du Château, est-ce que ce sont ceux où il a le droit de pénétrer ? Il va dans des bureaux, après ceux-là il y a une barrière, et derrière cette barrière encore d’autres bureaux..." Dédales, labyrinthes, escaliers sans fin, forment un décor cauchemardesque familier, à l’image de la ville qui les englobe : "(..) la rue, fuyant en droite ligne entre deux rangées de maisons coupées à la hache, allait se perdre dans un lointain où surgissaient formidablement, du sein d’une épaisse vapeur, les formes d’une cathédrale. Et, le matin comme le soir, et dans les rêves de la nuit, cette rue était le théâtre d’une circulation fiévreuse qui, vue d’en haut, se présentait comme un mélange inextricable de silhouettes déformées et de toits de voitures de toutes sortes, mélange compliqué sans cesse d’une infinité de nouveaux afflux, et d’où s’élevait un autre amalgame, encore plus forcené que lui, de vacarme, de poussière et de bruits répercutés, le tout happé, saisi, violé, par une lumière puissante qui, dispersée, emportée, ramenée à une vitesse vertigineuse par le tourbillon des objets, formait au-dessus de la rue, pour le spectateur ébloui, comme une épaisse croûte de verre qu’un poing brutal eût fracassée à chaque instant..." (L’Amérique).
Le fantastique urbain de Kafka me donne la nostalgie des pages les plus noires de Lovecraft décrivant des villes souterraines ou autres, en fait, il me donne la nostalgie de toutes les villes les plus terribles, celles de Lovecraft, celles de Baudelaire aussi : "O Cité ! Pendant qu’autour de nous tu chantes, ris et beugles, /Eprise de plaisir jusqu’à l’atrocité..." ; "Pendant que des mortels la multitude vile, /Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans merci,/Va cueillir des remords dans la fête servile... ;"
C’est que, même atroce, infâme, maudit, réprimé, il était là quand même, encore, ce plaisir ! Et cela avait quelque chose au moins de rassurant ! Ici la ville, comme la vie, n’en recèle aucun. Elles ne forment plus qu’une seule machine à broyer les individus, dont nous ne sommes que les victimes, ou, au mieux, d’infimes rouages... Plus de bien ni de mal, plus de Dieu, plus de Faust. Assumer tous les jours un devoir incompréhensible, mettre toute son intelligence, tout son effort à comprendre, à chercher à atteindre le Château : vivre. Vision très réjouissante, n’est-ce pas ?
Cette souffrance intense, familière, réclame un apaisement. J’appelle à moi Baudelaire, les vapeurs de l’opium, l’Ennui, le Spleen bienheureux : "Sois sage, O ma Douleur ! Et tiens toi plus tranquille..."/(...) "Ma Douleur, donne-moi la main, viens par ici, /Loin d’eux..."
J’aspire aujourd’hui à la fin de cette nuit, de la nuit générale, de l’angoisse permanente, de Kafka à tous les films innombrables qui s’inspirent de son oeuvre, en passant par les avis d’huissiers, les commandements de payer, les recommandés qui s’accumulent. Ouf ! Y a-t-il encore une issue possible au fantastique ? Je ne suis pas d’un naturel pessimiste, je crois bien que oui, que le matin vient, et qu’en ouvrant la fenêtre je me trouverai face à la vision de Rimbaud, que je pourrai dire avec la même émotion, le même émerveillement bouleversé : "Elle est retrouvée ! Quoi ? L’Eternité :/ C’est la mer allée/ Avec le soleil !".
Oui, bien sûr... Le soleil, la mer, l’éternité, une petite maison à la campagne... C’est beau, mais, méfiance : est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose aussi, cet apaisement soudain, cette vision heureuse... Peut-être n’est-ce que l’effet nirvana de la souffrance, comme à la fin de Brazil, quand le héros, tout aussi innocent que le jeune K., arrive au bout de la séance de torture, et qu’il hallucine le bonheur ? Mieux vaut se dire, plus prudemment, que demain il fera jour...






